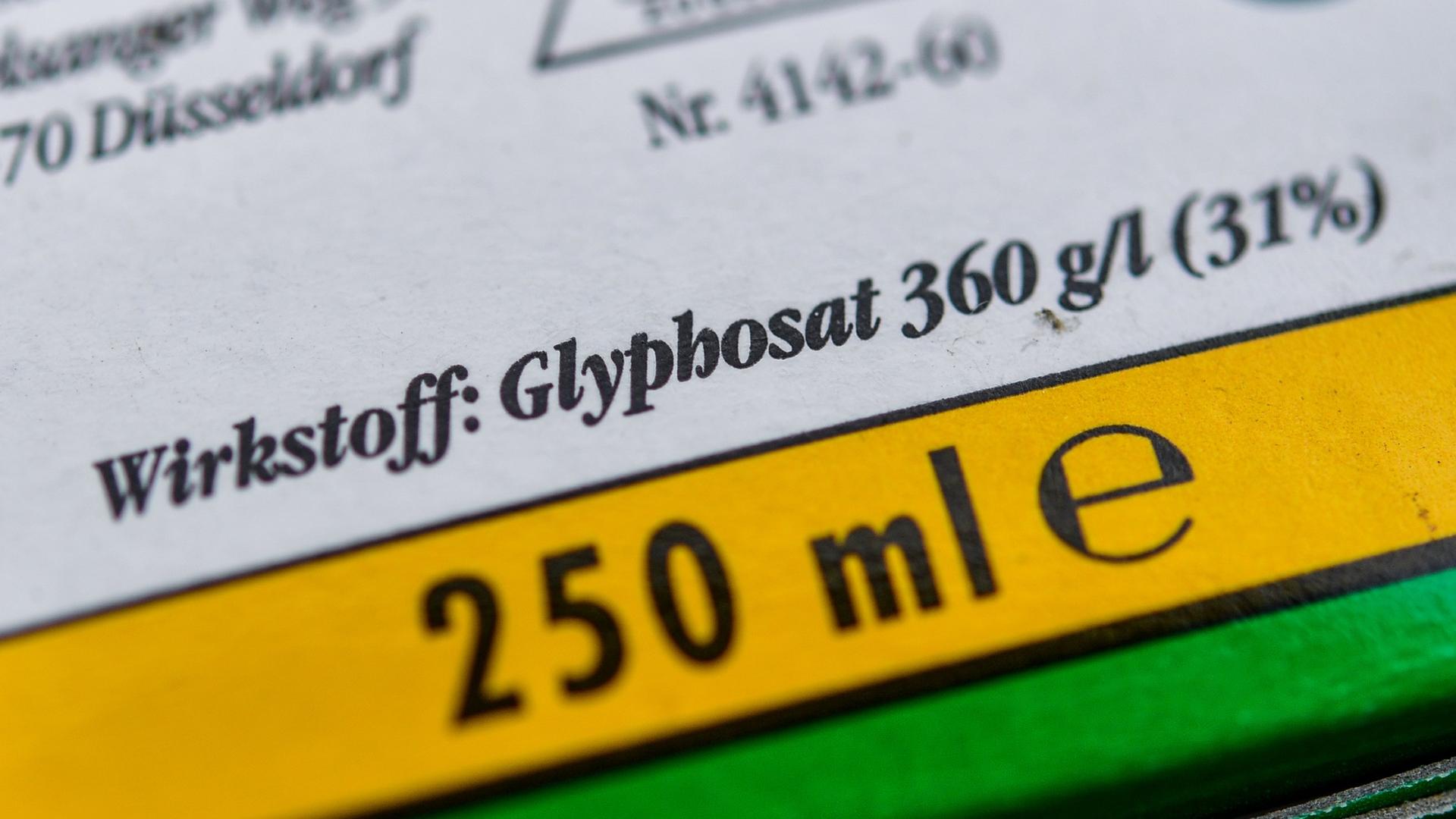February 21st, 2019 by Charles Goerens

L'Europe vue par l'Italie.
L’Italie va-t-elle nous réserver de grosses surprises? Difficile à dire, après avoir entendu le Président du Conseil comme il convient d’appeler le Président du gouvernement italien qui s’est prêté à un débat sur l’avenir de l’Europe la semaine dernière en plénière à Strasbourg.
Sa position au sein de son gouvernement peut cependant laisser subsister un doute sur la fiabilité de l’un des six pays fondateurs de l’Union européenne.
L’on sait qu’il doit sa nomination à l’incapacité de la Lega de Salvini et du Mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo de se mettre d’accord sur un premier ministre issu de l’une de leurs formations. Pour montrer que la position de Monsieur Conte est tout sauf stable, il suffit de relire les réactions des chefs de file des groupes politiques au discours de Monsieur Conte. Guy Verhofstadt l’a même qualifié de pantin de Salvini et Di Maio.
Les récentes prises de position du gouvernement italien nous apprennent toutefois que le ton correct de Monsieur Conte ne réussit pas à masquer la radicalisation du discours de l’équipe au pouvoir dans son pays.
Rappelons-nous l’incitation à la déstabilisation du Président Macron par le ministre de l’intérieur Salvini ou les tergiversations de Rome à propos du prochain budget italien, au départ jugé irrecevable par le commissaire Moscovici.
Il faut espérer que la raison prenne le dessus dans les relations Bruxelles-Rome.
Le débat avec Conte a révélé un autre aspect très caractéristique de l’Union européenne : le clivage qui oppose les partis traditionnels aux partis populistes. Les critiques, certes justifiées, formulées à l’endroit de Salvini et co. ne devraient pas faire apparaître la plupart des autres gouvernements européens comme les détenteurs de la seule perfection.
A y voir de plus près, la bien-pensance de d’aucuns se révèle être de l’hypocrisie au plus haut degré. On a laissé l’Italie seule avec ses réfugiés alors qu’on aurait dû s’entendre sur un partage des charges concernant l’accueil de migrants. En pareilles circonstances, on ne joue pas les vierges effarouchées.
Ce refus de solidarité n’a fait que renforcer petit à petit les populistes et les partis d’extrême droite. Ironie de l’histoire : le AFD, le Rassemblement national, ancien Front national et le FPÖ, entre autres, voulant fermer leurs frontières nationales aux migrants, n´accordent pas le moindre soutien à l´Italie où Salvini, l´un de leurs proches et alliés est au pouvoir. Autrement dit, quand les vrais problèmes apparaissent, les grandes gueules de l´extrême droite n´ont rien à offrir qui va au-delà du verbiage.
January 10th, 2019 by Charles Goerens
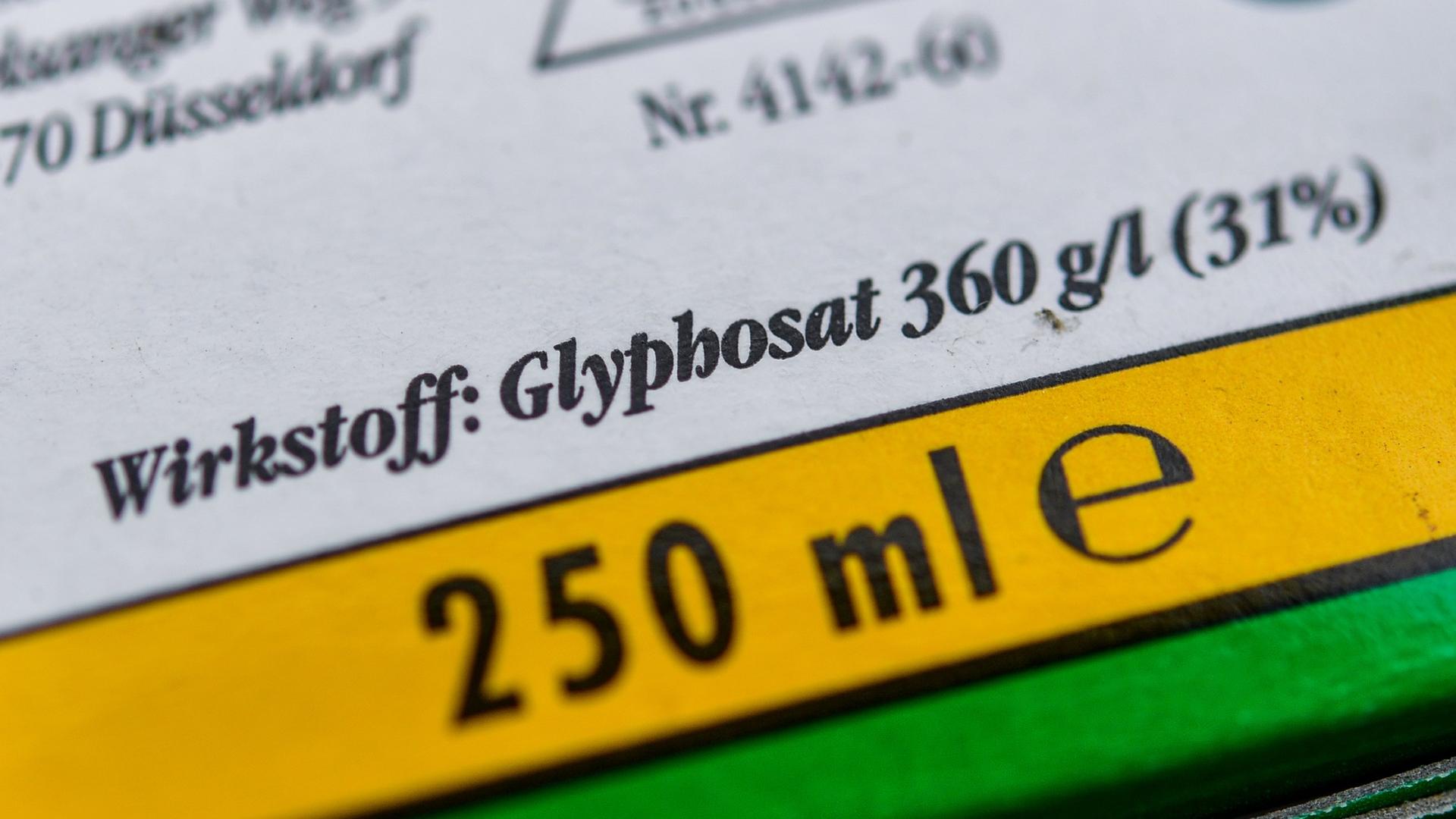
La cohérence.
L’annonce de l’interdiction du glyphosate a été hâtée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L’OMS avait déclaré, en effet, que le glyphosate pourrait être cancérigène. Dans une prise de position ultérieure, la même OMS s’exprime de façon plus nuancée en précisant que le glyphosate appliqué raisonnablement ne doit pas inquiéter.
Les réactions de l’opinion publique n’ont pas tardé à se manifester. Entretemps, le débat sur le sort à réserver au désherbant total le plus répandu dans le monde n’a cessé de prendre de l’ampleur.
Le traitement politique de cette problématique, pourtant, est tout sauf évident, même si à première vue, le choix se réduit à deux solutions: le renouvellement de l’autorisation du glyphosate ou son interdiction. En pareille circonstance il me paraît judicieux d’assortir la recherche d’une solution de critères et de conditions très stricts.
En l’occurrence, le respect du principe de précaution doit primer sur toute autre considération. Ledit principe, dans son application, donne la priorité à la santé publique. En clair, la mise en vente d’un produit qui nuit à la santé humaine n’est pas autorisée par l’autorité politique compétente, à savoir la Commission européenne.
L’approche américaine est très différente. Certes, les États-Unis, loin de négliger les aspects relevant de la santé publique, misent plutôt sur la dissuasion. Ainsi un produit déjà en vente, jugé préjudiciable à la santé humaine peut-il, à l’issue d’une procédure judiciaire, frapper de sanctions financières très importantes le producteur.
Quant à l’UE, pour ce qui est de cette dernière, fidèle au principe de précaution, celle-ci intervient au moment de la procédure d’autorisation du produit en question. Dans un cas, le produit nocif n’est pas ou plus autorisé sur le marché tandis que dans l’autre, la menace de sanctions très importantes dissuade le producteur à prendre de risques inconsidérés.
Quoiqu’il en soit, il va falloir s’accommoder à l’idée que l’interdiction du glyphosate dans la seule Union européenne ne répond que de façon imparfaite aux exigences d’une politique de santé préventive. S’il est interdit de recourir au glyphosate dans l’agriculture européenne, il n’en est pas de même pour les producteurs de soja américains ou brésiliens qui continuent allègrement de le pulvériser dans leurs campagnes et d’écouler leurs produits sur nos marchés. Résultat des courses: le principe de précaution, appliqué de façon cohérente, devrait en toute logique bannir l’importation de denrées alimentaires originaires de pays qui tolèrent encore l’utilisation du glyphosate chez eux dès l’entrée en vigueur de l’interdiction de celui-ci dans l’Union européenne.
November 15th, 2018 by Charles Goerens

Luxembourg, 15/11/2018
Le moment fort de la session de novembre du Parlement européen a été sans aucun doute le discours de la chancelière allemande Angela Merkel.
Ceux qui s’attendaient à une réaction au discours que le Président Macron avait prononcé à la Sorbonne il y a un an en sont restés pour leurs frais.
Cela n‘entame en rien, cependant, la qualité de son intervention qui a porté avant tout sur le contexte actuel, difficile pour la construction européenne. Elle a regretté l’absence de solidarité, « condition indispensable au fonctionnement de toute communauté » selon ses propres termes.
Consciente des impératifs de la realpolitik, elle est restée modeste, qualité que l’on rencontre trop rarement dans la sphère politique. Aussi a-t-elle fait preuve d’autocritique en rappelant que l’Allemagne ne s’est pas toujours comportée comme elle aurait dû notamment dans le contexte de la crise des réfugiés. Fidèle à elle-même, elle n’a néanmoins rien cédé sur le fonds, rappelant qu’en 2015 Orban avait demandé à l’Autriche d’accueillir des réfugiés dont il ne voulait plus et que l’Autriche, à son tour, s’était tournée vers l’Allemagne pour prendre en charge les personnes fuyant la guerre, la torture et le viol. C’est l’unité d’une personne qu’il y a lieu de saluer au regard de la responsabilité qu’elle a assumée dans ce fameux contexte de l’automne 2015. Pour Madame Merkel, la solidarité dont elle s’est réclamée tout au long de son discours n’est pas une vaine formule. Celui qui entend porter un jugement sur son action politique, qui commence à toucher à son terme, ne peut faire l’impasse ni sur ses convictions profondes, ni sur sa méthode de travail. Cela aussi faisait partie de son message aux députés européens. Exposée aux influences les plus diverses au cours de sa vie, la chancelière a réussi à rester néanmoins très entière.
Des allures d’adieu
September 21st, 2017 by Charles Goerens

Luxembourg, 21/09/2017
Avec le Brexit nous ne serons pas encore arrivés au bout de nos peines. Ainsi avec la subtilité britannique en moins, les dirigeants actuels de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque ainsi que de la Slovaquie, tentés par le populisme, voire le nationalisme, font-ils tout pour bloquer d’importants chantiers de la construction européenne.
Non seulement il n’y a pas l’ombre d’une réaction de leur part à l’appel de leurs partenaires pour répartir les charges inhérentes à l’accueil des réfugiés, mais encore refusent-ils carrément d’appliquer des mesures décidées par l’Union européenne. De plus, pour ce qui est de la Pologne et de la Hongrie, ces deux Etats membres vont même jusqu’à porter atteinte au bon fonctionnement de la justice ainsi qu’à la liberté de la presse.
On s’aperçoit donc aujourd’hui qu’il ne suffit pas de respecter les principes fondamentaux, et parmi eux les droits de la personne, basés sur la non-discrimination et la dignité humaine, au moment de devenir membre de l’Union européenne. Aussi faut-il les faire respecter de façon pérenne. Et c’est là, précisément, que le bât blesse.
Certes, le Traité laisse à la Commission européenne, qui en est sa gardienne, la possibilité d’initier un mécanisme de sanctions à l’endroit d’un État membre défaillant, prévu par l’article 7, pouvant, le cas échéant, priver un État membre de son droit de vote au Conseil de l’Union pour une durée déterminée. Pour devenir effective, la sanction proposée par la Commission doit être entérinée par les autres États membres à l’unanimité. L’inefficacité notoire de cette disposition saute aux yeux dès lors que la Hongrie a déjà annoncé vouloir faire barrage à la proposition éventuelle de la Commission de vouloir appliquer l’article 7 à la Pologne.
Comment mettre fin à une situation où l’unanimité est requise pour rétablir le respect du droit alors qu’il suffit qu’un seul membre s’en écarte ? Faut-il s’en accommoder ? Non car plutôt que de céder à la fatalité, il serait judicieux de faire du respect des valeurs fondamentales par les Etats membres la priorité absolue et d’adapter le Traité en conséquence. Approfondissement de l’Union européenne avant toute autre chose donc. Cela ne pourrait pas rester sans effet sur l’évolution de chantiers importants de l’UE et notamment son élargissement.
L’on pourrait voir dans pareille proposition une mesure susceptible d’irriter passablement les candidats à l’adhésion. Certes, mais pas nécessairement de façon durable. D’abord, rien n’est figé à tout jamais et, par ailleurs, n’est-il pas dans l’intérêt-même de la Serbie, du Monténégro, de l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine, du Kosovo et de l’Albanie, pays qui, naguère encore, ont connu la guerre ou la dictature, parfois les deux à la fois, d’adhérer à une Union européenne qui ne laisse pas planer le moindre doute sur sa capacité de faire respecter le principe de l’Etat de droit et les valeurs fondamentales. Pour l’instant la Pologne et la Hongrie privent l’UE de cette capacité.
L’on pourrait néanmoins s’imaginer que, dans un avenir prévisible, les cinq pays candidats des Balkans, sans pouvoir devenir membres officiels à ce stade, pourraient bénéficier, pour ainsi dire, de tous les avantages des politiques européennes sans pouvoir pour autant participer au processus décisionnel. Tout sauf les institutions, en quelque sorte.
Il pourrait être mis fin à cette période d’attente dès que l’UE aura réussi à se doter de règles strictes qui soient de nature à faire respecter, sans équivoque, ses valeurs fondamentales. Le respect des priorités impliquerait, au cas où l’UE ferait siennes les vues exposées ci-dessus, que l’approfondissement devrait précéder, en toute logique l’élargissement. Aux dirigeants de la Hongrie et de la Pologne de rentrer dans le rang avant toute autre chose.
Approfondissement avant élargissement
July 13th, 2017 by Charles Goerens

Luxembourg, 13/07/2017
L’UE: l’état de grâce
A en croire Eurobaromètre, l’euroscepticisme serait en net recul. Il n’y aurait donc en ce début d’été plus d’obstacles à une relance de l’intégration européenne? Pas si sûr. Certes, aucun Etat membre de l’Union européenne, à l’heure actuelle, n’envisage de quitter l’UE, même pas les pays de Višegrad – la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie ou la Slovaquie. L’on doit notamment à la “bande des quatre” l’opposition catégorique à tout partage des charges en matière d’accueil des réfugiés. Si leurs dirigeants tendent la main à leurs partenaires, c’est pour recevoir. Par contre, ils secouent la tête dès qu’on leur réclame un rien de solidarité. La crise dite des réfugiés a pu mettre en évidence l’attitude lamentable de la plupart de nos Etats membres dès que la nécessité d’agir en commun se manifeste.
Quant aux élections législatives qui ont eu lieu aux Pays-Bas et en France, leur issue a été franchement rassurante. Les détracteurs de l’Europe n’ayant pas réalisé le score espéré restent écartés du pouvoir exécutif dans leur pays respectif. Pour le reste, le Président Trump, favorable au Brexit et appelant de ses vœux la fin de l’UE, a réussi, sans le vouloir, à réveiller les Européens. Ceux-ci prennent enfin conscience de leurs responsabilités, du jamais vu si l’on fait abstraction du séisme politique déclenché par la fin de la guerre froide et des tout débuts de la construction européenne dans les années 1950.
Tout serait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes? Pas tout à fait. Les adeptes d’une Europe plus solidaire, plus unie et plus démocratique savent pertinemment que l’embellie observée dans le ciel européen pourrait rester assez limitée dans le temps et ce pour une raison évidente. Un rôle clé revient, en effet, à la France et à l’Allemagne. Le nouveau Président français a encore devant lui un peu moins de cinq ans pour initier ou contribuer à faire évoluer les grands chantiers européens ensemble avec les autres Etats membres, et avant tout avec l’Allemagne qui, elle, dispose encore de moins de temps, les élections allemandes ayant lieu tous les quatre ans.
Or quatre ans, c’est très peu si l’on veut faire aboutir des réformes institutionnelles, voire des changements de traité. Et pourtant, le vieux continent, s’il ne veut pas finir par être déclassé, doit améliorer son fonctionnement, se rendre compte que la fin de la tutelle américaine le place devant l’immense responsabilité de prendre en mains son propre destin. Il sera douloureux, le processus d’émancipation des Vingt-sept. Ce n’est pas pour autant une raison de l’esquiver. Macron a pris des engagements courageux lors de sa campagne électorale. La chancelière allemande, encore très évasive dans ses prises de position au lendemain de l’élection présidentielle française, semble avoir compris, entretemps, qu’elle devra emprunter la voie tracée par Macron.
On aura rarement vu réunies tant de conditions à la relance du projet européen qu’en cette année 2017. Cependant, il faut se garder de crier victoire trop tôt, car le temps présent est tout au plus un état de grâce. On sait quand il commence, mais personne ne peut prédire sa durée. Il importe dès lors de saisir la présente opportunité sans perdre une seule journée. N’oublions pas que, contrairement à l’état d’urgence, un état de grâce ne peut pas être prolongé par une décision politique.
L’UE: l’état de grâce
May 11th, 2017 by Charles Goerens

Le Jeudi, 11/05/2017
Même si la fête de l’Europe ne mobilise pas les foules, il ne viendrait à l’esprit de personne de la rayer de l’agenda. Journée de l’espoir pour les uns, qui laisse indifférents les autres, elle reste l’occasion de renouer avec les tout débuts de l’intégration européenne. Cette année, elle a été précédée par deux événements lourds de conséquences pour la vie à vingt-sept. Deux événements qui ont constitué une épreuve et une preuve à la fois.
Le 15 mars, les néerlandais sont allés aux urnes dans un climat d’incertitude quant à leur avenir européen. Leur verdict, cependant, a été sans équivoque : leur vote n’a pas donné lieu à une crise existentielle pour l’UE.
Dimanche dernier, les électeurs français, après avoir éliminé les deux piliers traditionnels de vie politique française, les Républicains et le Parti Socialiste, n’ont pas hésité à barrer la route au Front National. Le vainqueur de ce duel, Emmanuel Macron, a pris le risque de thématiser la construction européenne. Son courage a été récompensé. En 2017, donc, ni les Français, ni les Néerlandais, du moins majoritairement, n’ont envie de jouer avec le feu. En sera-t-il encore de même dans quatre ou cinq ans lorsqu’ils seront de nouveau appelés à renouveler leur Assemblée? Le doute reste permis, car même si les souverainistes ont été mis en échec, leur progression reste toutefois spectaculaire. Geert Wilders tout comme Marine Le Pen ont réussi à élargir considérablement leur base électorale. Le « ouf » des pro-européens, ne serait-il que l’expression d’un soulagement éphémère? La période qui est devant nous ne constituerait-elle qu’un nouveau et peut-être ultime sursis pour l’UE? Rien ne permet, à priori, d’écarter définitivement cette hypothèse. Le maintien du système politique actuel est tout sauf un garant de la pérennité de l’UE. Pour preuve, à peine élu, Emmanuel Macron soucieux de sortir la construction européenne de son ornière, se voit attaqué de toutes parts. Dans les 24 heures qui ont suivi la proclamation du résultat, on voit déjà les détracteurs descendre dans la rue. Quelques heures plus tard, on entend déjà outre-Rhin des voix s’élever catégoriquement contre tout changement dans la politique de l’Euro.
N’aurait-on dès lors rien appris de cette élection? N’a-t-on pas vu les électeurs français balayer la classe politique française? Croit-on vraiment que l’on pourra passer à l’ordre du jour sans la moindre remise en question de notre façon de vivre ensemble? Si en cette journée de l’Europe, dédiée avec beaucoup de sympathie à Robert Schuman, l’un des pères fondateurs de l’Europe, nous n’arrivons pas à aller au-delà des rituels de commémoration et d’incantations déjà presque pavloviens en faveur de l’Union européenne, nous manquons tout simplement à notre devoir.
Photo (c) Politico
Le doute reste permis, car même si les souverainistes ont été mis en échec, leur progression reste toutefois spectaculaire.
March 14th, 2017 by Charles Goerens

13/04/2017, Le Jeudi
La relance de l’Europe par le citoyen
Difficile de s’imaginer nos citoyens souhaiter la fin de nos institutions en cas de profond désaccord avec la politique menée. En pareille circonstance, ils souhaitent le remplacement de l’équipe dirigeante lors des prochaines élections sans vouloir pour autant mettre fin à la Chambre des députés ou au gouvernement. Les mêmes causes, cependant, ne génèrent pas nécessairement les mêmes effets dès lors qu’il s’agit de la politique nationale ou européenne. En France et aux Pays-Bas, par exemple, des mouvements nationalistes, en désaccord avec la politique de l’Union européenne s’en prennent carrément à ses institutions et veulent soit les quitter soit mettre fin à leur existence.
Le but affiché des nationalistes, c’est tout simplement la désintégration de la construction européenne. En cas de victoire de leur camp, ils s’engagent à laisser le peuple décider par voie référendaire de la sortie de leur pays de l’Union européenne.
Pour ceux qui en doutaient encore, le processus d’intégration européenne n’est plus irréversible, situation impensable il y a une dizaine d’années. En effet, si les Le Pen et Wilders devenaient majoritaires dans leurs pays, cette Union, dont tous les pouvoirs qu’elle détient lui ont été transférés par les Etats membres, serait jetée en pâture à une opinion publique en désarroi. En cas de victoire de l’extrême droite dans ces deux pays, on voit mal ce qui pourrait encore s’opposer à la fin de l’Union européenne. Finie alors la rengaine éternelle du possible retrait de l’UE sur son noyau dur pour limiter les dégâts étant sous- entendu que le noyau dur ne serait autre chose que les six pays fondateurs. Or le cœur de l’Europe est atteint et l’on verrait mal les six pays fondateurs relancer la construction européenne si la France ou les Pays-Bas s’apprêtaient à lui tourner le dos. Ajoutons aussi que le rapport à l’UE des autres Etats fondateurs, à l’heure actuelle, est tout sauf euphorique.
Y-a-t-il encore un faible espoir de voir l’UE retrouver une nouvelle dynamique? Rien n’est moins sûr étant donné que toutes les incantations des responsables des institutions gouvernementales ou parlementaires tant européennes que nationales n’ont produit jusque-là que de très faibles résultats. Rares sont ceux parmi les dirigeants politiques nationaux qui continuent à considérer l’Europe comme une priorité. Aussi la campagne présidentielle française montre-t-elle à quel point l’Europe est absente du discours des prétendants à la magistrature suprême.
Il y a lieu, en ces temps dramatiques, de s´interroger sur les vraies raisons de ce désamour. Parmi les causes du rejet souvent citées, retenons l’incapacité de la gouvernance actuelle d’humaniser la globalisation. Le philosophe Jürgen Habermas affirme que si la globalisation affaiblit les gouvernements et les parlements nationaux, il importe de développer une coopération internationale démocratiquement légitimée. Peut-on s’imaginer meilleur éloge pour l’Union européenne qui, de toute évidence, constitue le cadre idéal pour développer cette coopération?
Comment dès lors pérenniser la construction européenne si les piliers sur lesquels elle repose- en l’occurrence les Etats membres- font l’objet de secousses de plus en plus violentes? Et si, au moment où le doute s’installe sur la capacité des 28 Etats membres de supporter la construction européenne, on remettait le citoyen au centre du projet européen? Les déçus du résultat du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni font preuve d’un profond attachement aux valeurs fondamentales de l’Union européenne. C’est parmi eux que nous trouvons les plus ardents défenseurs de la citoyenneté européenne. Les vrais Européens aujourd’hui, ce sont ces millions d’Anglais, d’Ecossais, de Gallois et d’Irlandais du Nord qui risquent d’être déchus de la citoyenneté européenne. Ils nous témoignent de jour en jour que l’Europe est une affaire de cœur. Nous aurions tort d’ignorer leur appel et de réserver une fin de non-recevoir à leur attente de rester, malgré le Brexit, d’une certaine façon, citoyens européens. Ne leur tournons pas le dos! Chapeau bas à ces millions de femmes et d’hommes qui nous font redécouvrir le citoyen au sens noble du terme avec sa capacité de se mobiliser. Nous leur devons quelque chose car ils nous indiquent la voie à suivre.
Si, en effet, on pouvait observer la même ferveur dans les vingt-sept autres Etats de l’Union, on n’aurait plus de soucis à se faire pour la cohésion de l’Europe. La relance de l’Europe par le citoyen a plus de chances d’aboutir que si l’on confiait cette tâche indispensable aux seuls dirigeants des institutions nationales et européennes souvent considérées, à tort d’ailleurs, comme des monstres abstraits.
La relance de l’Europe par le citoyen
February 9th, 2017 by Charles Goerens

Le Jeudi, 09/02/2017
Un Occident sans repères?
Les primaires et, plus tard, la campagne électorale proprement dite, nous avait fait découvrir un personnage peu conventionnel. Le candidat Trump, grande gueule, sans la moindre expérience politique, profanant des propos plus que maladroits à l’endroit des femmes, n’avait apparemment pas la moindre chance de sortir vainqueur des élections présidentielles. Et puis, de toute façon, même dans l’hypothèse la plus invraisemblable de son élection, on s’attendait à le voir, une fois investi, incarner la posture de l’homme d’Etat.
Rien de tel depuis le 9 novembre 2016, on s’est tous trompés. Les sondages annonçant tout au long de la campagne la victoire de Hillary Clinton? A côté! Et la loi, pour ainsi dire naturelle, selon laquelle, dès la prise de ses responsabilités, le nouveau Président allait grandir dans sa fonction? Grande illusion! Et la certitude que les structures transatlantiques, contrairement à celles imposées par l’Union soviétique jusqu’à l’an 1989 allaient résister à l’usure du temps? Le doute s’installe! Quid d’un ordre mondial marqué par l’influence américaine, basé sur le droit, le principe de non-discrimination, la liberté et la solidarité? Des certitudes qui s’ébranlent!
Comment appréhender dès lors le système Trump à trois semaines à peine de son sacre? Celui qui s’était présenté comme le candidat du peuple, à mille lieues de l’« establishment », ne fait pas dans la dentelle. Avec une rare brutalité, il s’apprête à mettre en œuvre, une à une, les mesures annoncées au cours de la campagne électorale. Ceux qui avaient pris ses propos de campagne pour des histoires à dormir debout vont finir par reconnaître qu’il fallait le prendre au mot.
Rien ne va changer? Tout va changer! L’OTAN, dont le Traité met en avant le principe de l’assistance mutuelle en cas de conflit, est rongée par le doute. Les Etats-Unis, longtemps opposés à l’émancipation des Européens au sein de l’Alliance atlantique, considèrent celle-ci comme démodée et incitent l’Union européenne à un accroissement des dépenses militaires sans précédent. Payer plus cher pour moins de sécurité? Nos dirigeants sont en désarroi. En ce 6 février, Trump relativise ses propos sur l’OTAN. Le mal est fait. Il n’y a plus de continuité dans les relations extérieures des Etats-Unis.
Quant au volet extérieur de la politique économique des Etats-Unis, le mot d’ordre de Trump est “America first”. Le protectionnisme serait de retour. L’Union européenne, déjà passablement affaiblie par le Brexit que Trump appelle de ses vœux, s’accommoderait mal d’un recul sensible de ses exportations.
Autant de raisons pour les Européens de resserrer les rangs, de revoir les fondements de la construction européenne, de décider des réformes susceptibles et de se doter enfin des structures décisionnelles appropriées. Une question de volonté politique, quoi. Faut-il avoir peur de Trump? Oui, si nous nous installions dans une atmosphère de fatalité. Non, à condition d’être conscients de nos potentialités et d’agir en conséquence.
Un Occident sans repères?
Les primaires et, plus tard, la campagne électorale proprement dite, nous avait fait découvrir un personnage peu conventionnel. Le candidat Trump, grande gueule, sans la moindre expérience politique, profanant des propos plus que maladroits à l’endroit des femmes, n’avait apparemment pas la moindre chance de sortir vainqueur des élections présidentielles. Et puis, de toute façon, même dans l’hypothèse la plus invraisemblable de son élection, on s’attendait à le voir, une fois investi, incarner la posture de l’homme d’Etat.
December 8th, 2016 by Charles Goerens

Chronique Le Jeudi, 08/12/2016
La rage destructrice de l’extrême droite
La perfection n’est pas de ce monde. Cela vaut pour tous les êtres humains, même pour le Pape, dont l’infaillibilité, comme l’admet l’Eglise catholique elle-même, n’est pas absolue étant donné qu’elle ne s’applique qu’aux questions dogmatiques. Qu’en est-il dès lors du monde politique? Nous devons à Willy Brandt ce constat très pertinent selon lequel les politiques “sind keine Auserwählte sondern Gewählte”. Si les deux termes se traduisent par le même mot, le premier est à connotation élitiste tandis que le second veut simplement dire “élu”. Ne qualifie-t-on pas à tort d’élite les dirigeants politiques, les journalistes, les responsables de la marche de l’économie, comme s’ils détenaient le pouvoir absolu et devaient être infaillibles ès qualité? Il s’agit en l’occurrence de personnes qui, dans leur action, se trompent, commettent des erreurs, peuvent être fautifs et sont de ce fait sujets à critique, mais ils ne sont pas que cela. En acceptant les fonctions qui sont les leurs, ces personnes s’exposent tout naturellement à des critiques. Jusque-là rien à redire si ce n’est la mauvaise foi qui, souvent, anime leurs détracteurs.
La vague de déconsidération qui déferle actuellement sur l’Europe est donc à prendre très au sérieux. Quand l’approximation, la caricature, l’insinuation, les contrevérités, voire le mensonge tiennent lieu de débat public, il devient urgent de tirer la sonnette d’alarme. Les Vingt-huit ne sont pas à même de répartir les réfugiés équitablement entre eux. Est-ce la faute à l’Europe? Non, parce que celle-ci est bloquée par des Etats membres dirigés par des populistes qui ne veulent accepter aucun réfugié sur leur territoire. Privant l’Europe du transfert des compétences indispensables pour pouvoir traiter humainement l’accueil des réfugiés, les Etats membres qui sont déjà minés par des courants populistes, reprochent ensuite à l’Europe son incapacité d’agir. N’est-ce pas le fruit de ce crétinisme qui risque désormais de relayer le devoir moral et légal auquel avaient souscrit tous les Etats membres dans des textes codifiant le devoir d’assistance aux réfugiés?
Merkel agit en conformité avec la convention de Genève en matière d’accueil des personnes fuyant la guerre et la torture. Elle est critiquée par ceux-là même qui restent muets lorsque les fascistes mettent le feu aux centres d’accueil.
Renzi perd un référendum sur des réformes au système politique italien. Les populistes en profitent pour régler leurs comptes avec l’Union européenne.
Poutine protège et assiste le boucher d’Alep en lui prêtant main forte. Le même Poutine bafoue le droit international en Crimée et dans l’est de l’Ukraine. Pourtant l’extrême-droite, pas seulement française, le considère comme son ami et allié. Ami et allié fidèle, Poutine ne se laisse pas prier deux fois pour financer les partis occidentaux qui s’opposent à toute critique à son endroit. Cela n’empêche nullement les récipiendaires de la manne russe d’inciter l’opinion publique à la haine contre “l’establishment”, c’est-à-dire les forces qui assument leurs responsabilités gouvernementales dans l’une des phases les plus critiques de l’histoire de l’après-guerre.
Redoutables, ils le sont, ces gourous de l’extrême-droite, redoutables dans leur façon de communiquer, redoutables dans leur succès de convaincre à la fois des ouvriers qui, naguère encore, votaient pour l’extrême gauche, des paysans, des chefs d’entreprise déçus par la droite traditionnelle ou le centre, des policiers, des universitaires ou des commerçants ancrés à gauche ou à droite de se joindre à eux.
Ils affirment sans rougir qu’ils entendent rendre la liberté aux peuples de disposer d’eux-mêmes. Quelle liberté? La liberté de la presse, bafouée, intimidée ou muselée dans les pays dirigés par les populistes? La liberté des citoyens de circuler librement?
Comme ces libertés sont d’ores et déjà garanties par l’Union européenne, on est en droit de se demander ce que l’extrême droite entend par liberté des peuples de disposer d’eux-mêmes. En réalité, la liberté à laquelle ils aspirent n’est-elle pas celle où, une fois au pouvoir, ils peuvent disposer librement du peuple?
Laisser planer le flou sur cette question donne lieu aux pires inquiétudes. Quelle liberté pour les étrangers? Quelle liberté pour les minorités? Il faut en débattre. Nos citoyens veulent être éclairés. Aussi me semble-t-il judicieux d’éviter de faire l’amalgame entre toutes les grandes gueules qui, avec un petit verre sous le nez, ne maîtrisent plus la syntaxe et d’aucuns parmi les dirigeants de l’extrême droite.
Ainsi la seule référence à la liberté dans le troisième Reich se trouve-t-elle à l’entrée de plusieurs camps d’extermination: “Arbeit macht frei”. Pour Le Pen, la façon dont le travail a libéré les millions de juifs et les centaines de milliers de tsiganes entre 1940 et 1945 n’est qu’une question de détail. Les gens de cette trempe, il faut les prendre au mot. Si dans les années 1930 on n’avait pas pris les propos antisémites, xénophobes et racistes pour des élucubrations d’un délirant, on aurait sans doute pu laisser la liberté aux peuples d’Europe. Quand on s’en est aperçu, soixante millions d’Européens avaient payé de leur vie cette erreur d’appréciation.
La perfection n’est pas de ce monde. Cela vaut pour tous les êtres humains, même pour le Pape, dont l’infaillibilité, comme l’admet l’Eglise catholique elle-même, n’est pas absolue étant donné qu’elle ne s’applique qu’aux questions dogmatiques. Qu’en est-il dès lors du monde politique?
September 15th, 2016 by Charles Goerens

La politique n’est pas une science exacte
En effet, les grands événements font rarement l’unanimité dans nos conversations, sur les réseaux sociaux ou dans la presse, tant écrite que parlée. Quoi de plus normal dans une démocratie qui, par nature, est pluraliste? Non seulement la démocratie est plurielle, mais elle est aussi très résiliente. Elle dure et elle endure. Elle permet de faire coexister des points de vue diamétralement opposés. En facilitant la confrontation, elle protège avant tout la liberté d’expression de celles et ceux qui s’écartent du « mainstream ».
Ce constat vaut grosso modo pour la période d’après-guerre, du moins dans nos démocraties occidentales.
Abstraction faite de propos calomnieux ou mensongers, la liberté d’expression ne connaît guère de limites.
Tel n’est plus le cas en Turquie. Depuis la récente tentative de coup d’Etat, le Président Erdoğan fait mettre sous les verrous tous les citoyens supposés ne plus suivre la ligne du gouvernement. Si la Hongrie ne peut pas être accusée des mêmes faits, il est cependant indéniable que Viktor Orbán, à travers son « Conseil des médias », essaye de manière plus subtile de freiner les ardeurs d’une presse critique.
Quant à l’Europe occidentale, tout serait-t-il pour le mieux dans le meilleur des mondes? A première vue, la situation paraît être satisfaisante. Effectivement, chez nous, les dérives à la Erdoğan datent d’une autre époque. Par contre, ce qui dans notre façon de traiter de l’actualité politique pose problème, c’est notre manière de réagir à des phénomènes nouveaux comme le développement de l’extrême droite, par exemple. Diffuser en boucle le résultat électoral du parti
« Alternative für Deutschland » (AFD), finit par le rendre encore plus populaire. En présentant le AFD comme un mouvement en phase avec le peuple d’en bas, on l’oppose à une chancelière ayant apparemment perdu tout lien avec le citoyen. La prétendue fracture entre elle et le peuple allemand trouverait son origine dans son attitude favorable à l’accueil d’un million de réfugiés en 2015. S’il est vrai que le mécontentement auquel a donné lieu son attitude ouverte et humaniste en la matière lui a couté un nombre très important de voix, est-il normal de mettre en doute sa légitimité? Peut-on lui reprocher d’avoir accueilli à bras ouverts les personnes ayant fui l’horreur de la guerre quand la plupart des autres Etats membres de l’Union européenne ont fermé leurs frontières et donné ainsi une fin de non-recevoir aux demandeurs d’asile? Les Orban, Szydlo et autres dirigeants du Groupe de Visegrád font peu état du respect des dispositions du droit international qui les oblige à offrir la protection aux personnes fuyant la guerre.
En fait, le cortège des détracteurs de Madame Merkel lui fait un double reproche. D’un côté, elle est accusée de faire ce que le droit international lui impose et de l’autre, il lui est reproché de se substituer aux responsabilités que ses homologues ne sont pas prêts à assumer.
N’est-ce pas le monde à l’envers? L’information tend à présenter l’accueil des réfugiés comme la défaite du siècle, alors que les dispositions du droit national et international ne lui laissaient guère d’autre choix. Suggérer le comportement des fossoyeurs de l’humanisme, hostiles à un traitement humain des personnes en détresse, comme une attitude plus respectueuse de la volonté du peuple n’augure rien de bon. Loin de moi l’idée de rendre la presse responsable de ce malaise. Cela ne veut pas dire pour autant que l’on ne doit pas s’interroger sur le fait que les fascistes qui mettent le feu aux centres d’accueil de demandeurs d’asile font moins l’objet de critiques que les décideurs qui ne font rien d’autre que de donner un peu de perspectives à ceux qui avaient fini par perdre tout espoir.
Le clivage entre l’humanisme, dont s’est toujours réclamé l’Union européenne, et l’extrême droite décomplexée, refusant de respecter les droits fondamentaux y relatifs, ouvre une période d’incertitude, voire d’inquiétude. Il faut espérer que les défenseurs de la dignité humaine n’aient pas encore dit leur dernier mot. A chacun de nous, sans exception, de ne ménager aucun effort pour faire pencher le curseur du côté de l’humanisme et de l’acquis des Lumières.
Photo (c) Independent.co.uk
En effet, les grands événements font rarement l’unanimité dans nos conversations, sur les réseaux sociaux ou dans la presse, tant écrite que parlée. Quoi de plus normal dans une démocratie qui, par nature, est pluraliste? Non seulement la démocratie est plurielle, mais elle est aussi très résiliente. Elle dure et elle endure. Elle permet de faire coexister des points de vue diamétralement opposés. En facilitant la confrontation, elle protège avant tout la liberté d’expression de celles et ceux qui s’écartent du « mainstream ».
July 14th, 2016 by Charles Goerens

Luxembourg, 14/07/2016
Dans quatre mois les citoyens des États-Unis décideront si le destin de leur pays pour les quatre prochaines années sera confié à un homme ou à une femme. L’élue sera probablement Hillary Clinton, du moins faut-il l’espérer. À maints égards cette élection sera décisive. Pour les questions de paix intérieure d’abord, il ne sera pas anodin de savoir sur qui sera porté le choix. Les Américains vont devoir se départager entre Trump, la grande gueule, prêt à démarrer au quart de tour pour souffler sur la braise ou une dame dont on sait que, sans nécessairement faire l’unanimité, elle constitue tout de même une référence très solide pour ceux qui veulent une société plus inclusive, plus libre et plus juste. Cette élection sera importante également pour le reste du monde, et notamment pour l’Europe.
Quoiqu’il en soit, la personne élue sera influente, très influente. Son pouvoir s’exercera tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des États-Unis. Obama, dont le mandat arrivera bientôt à son terme, multiplie, entretemps, ses visites auprès de ses alliés depuis le début du printemps. Ses déplacements à Hanovre, au Japon ou à Madrid sont davantage assimilables à des cérémonies d’adieu plutôt qu’à l’ouverture de grands chantiers politiques. Les grandes orientations politiques sont d’ailleurs rarement arrêtées en fin de mandat présidentiel. L’on attend décemment qu’une légitimité nouvelle, conférée par le suffrage universel du 20 novembre prochain, mettra la nouvelle administration en position de force pour relever les nouveaux défis.
En clair: il n’y a plus eu de prise de décision importante par Washington depuis le début de l’année. À cela s’ajoute une période d’attente de deux mois entre le 20 novembre 2016, date de l’élection, et le 20 janvier 2017, jour du sacre du futur Président, suivi de l’état de grâce habituel des cent premiers jours après sa prise de fonction. Une fois le cap fixé et la stratégie mise au point, la nouvelle administration américaine reprendra les choses en main. Entretemps, quinze mois se seront écoulés sans que l’UE ait pu influer de façon effective sur les choix politiques de la superpuissance en matière internationale pour les quatre années du nouveau mandat. Or une implication résolue, au moment opportun, de l’UE dans la gestion des grands dossiers du monde est indispensable si nous voulons dépasser le stade de simple observateur. C’est maintenant qu’il faut signaler à la future Présidence ce que nous attendons des États-Unis en matière de sécurité, de politique étrangère et de défense de nos valeurs communes.
Quand est-ce que l’UE pourra laisser derrière elle cette incapacité notoire de faire valoir ses vues en temps opportun auprès de son principal allié pour tout ce qui est d’intérêt commun? La réponse à cette question est double. Pour être en mesure d’impressionner nos alliés, en parlant d’une seule voix, il faut d’abord avoir un projet commun, ce qui est loin d’être le cas. Au contraire, en 2016, les États membres de l’UE ressemblent à tout sauf à une communauté de destin. Ce qui est tout aussi important, c’est la méthode, le processus décisionnel, la capacité de se diriger vers une position commune. Quand on n’a ni l’un ni l’autre, on se prive de l’essentiel en politique: la capacité de faire bouger les lignes.
Photo (c) ABC11
L’UE condamnée à subir ou déterminée à agir?
May 26th, 2015 by Charles Goerens
Le Référendum britannique, bien plus qu’une affaire insulaire
En pleine guerre, le Président ukrainien, soucieux de voir son pays adhérer au plus vite à l’Union européenne, fait sa profession de foi pour l’Europe. Cela étant, il ne fait qu’exprimer un sentiment largement répandu dans une population en quête de stabilité, de paix et de prospérité, marquée par la perte de la Crimée et la guerre contre les séparatistes armés jusqu’aux dents par la Russie. La Macédoine, le Monténégro, l’Albanie, la Serbie et le Kosovo notamment attendent eux aussi avec impatience le jour de leur adhésion à l’Union européenne. En 2015, tout comme au cours des dernières décennies, il est vrai, l’Union européenne reste convoitée de toutes parts.
A l’intérieur, par contre, le rapport à l’Union européenne de certains de ses Etats membres est moins enthousiaste. Pour preuve, la faible participation aux élections pour le Parlement européen, qui, dans certains cas, n’atteint même plus 20%. Le taux de participation électorale, n’est toutefois pas le seul indicateur de désabusement d’une part de l’opinion publique de plus en plus eurosceptique. Il n’est dès lors pas étonnant de voir certains dirigeants, soucieux d’être en phase avec leurs citoyens, multiplier leurs déclarations eurosceptiques, souverainistes voire nationalistes.
Que l’Union européenne soit plus appréciée à l’extérieur qu’à l’intérieur n’est pas nouveau. Hans-Dietrich Genscher, l’ancien ministre allemand des Affaires étrangères n’avait-il pas l’habitude de dire que l’Europe était surestimée à l’extérieur et sous-estimée à l’intérieur de ses frontières? Dans tous nos Etats membres, certes, les adeptes de la construction européenne restent très nombreux. Les référendums français, néerlandais, irlandais ou danois sur les Traités de Maastricht ou sur le projet de Traité constitutionnel ont fait apparaître, cependant, dans nos sociétés des clivages laissant apparaître deux blocs à peu près égaux mais aux vues diamétralement opposées quant aux orientations à arrêter en matière d’intégration européenne.
Longtemps considérée comme construction pérenne, l’Union européenne arrivait toujours à surmonter tant bien que mal les difficultés passagères auxquelles elle devait faire face. Quelles qu’aient pu être les problèmes rencontrés, ces derniers n’ont jamais eu pour effet de remettre en cause l’existence même de l’Union européenne. Jusque-là, en tout cas, aucune crise, institutionnelle, économique ou monétaire ne s’est soldée par le départ d’un Etat membre de l’Union. Cela eût d’ailleurs été non conforme au droit européen. Ce n’est qu’à partir de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, et c’est nouveau, que la possibilité est ouverte à un Etat membre de quitter l’Union européenne.
Le Royaume-Uni est le premier pays à vouloir recourir à y recourir. Annoncé dans son fameux discours sur l’Europe du 23 janvier 2013, le Premier Ministre de sa Majesté en a fait un enjeu électoral. Jeudi dernier, les électeurs britanniques ont donné une majorité parlementaire à David Cameron, mettant ainsi ce dernier dans l’obligation d’organiser, comme annoncé lors de sa campagne électorale, un référendum en 2017 sur le maintien ou non de son pays dans l’Union européenne. La question sur laquelle les Britanniques seront appelés à trancher sera de savoir si le Royaume-Uni restera membre de l’Union européenne sur la base d’un Traité renégocié et plus conforme aux attentes de Cameron qui, pour l’instant du moins, est le seul à souhaiter que le Traité soit remis sur le métier.
Depuis jeudi dernier, la question du référendum n’est donc plus à considérer comme une affaire de politique purement intérieure du Royaume-Uni pour la simple raison que toute modification du Traité requiert l’accord unanime des Etats membres. Cameron n’est de ce fait aucunement maître du jeu. Certes, il lui incombe de fixer la date de la consultation ainsi que la question du “in or out”. Pour l’essentiel, cependant, cette opération reste une devinette. En effet, les vingt-sept partenaires du Royaume-Uni vont-ils accepter l’ouverture d’une conférence intergouvernementale-préalable à la modification du Traité – portant sur les réformes exigées par Cameron? Dans l’affirmative, pourront-ils s’entendre sur la nature des concessions à lui accorder ? Si, par contre, Cameron n’arrivait pas à convaincre ses partenaires, les choses resteraient en l’état et le référendum porterait sur le maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne, version actuelle.
En définitive, le choix des Britanniques portera sur leur maintien dans l’Union européenne version “light” que Cameron appelle de ses vœux ou dans une “Union sans cesse plus étroite”. Ainsi revient-il à Cameron de fixer la date du référendum et aux autres Etats membres de préciser le contenu de la question qui en fera l’objet, situation peu confortable pour un Premier Ministre qui veut rester maître de son destin…
April 9th, 2015 by Charles Goerens
La fin des quotas laitiers
Le régime des quotas laitiers a pris fin le 31 mars dernier. En vigueur dans l’Union européenne depuis 1984, la fin du système des quotas laitiers est synonyme de fin d’une époque. En effet, au cours des trente dernières années, les fermiers s’étaient vu imposer des limites dans la production laitière. Des contingents attribués à chaque Etat membre étaient fixés en fonction du niveau de production laitière atteint au cours d’une période de référence précédant l’entrée en vigueur du régime des quotas. Un “superprélèvement” devait pénaliser les Etats membres dont la production laitière allait être excédentaire.
Le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, la France et tous les autres savaient dorénavant à quoi s’en tenir. Le respect du seuil de production était à considérer comme une obligation de résultat. Quant aux moyens à mettre en oeuvre pour y arriver, l’Union européenne laissait les Etats membres opter pour celles des modalités qui leur paraissaient les plus appropriées lors du passage du régime de liberté totale de production à celui interdisant de produire au-delà d’un certain seuil. Fallait-il traiter de la même façon un jeune agriculteur ayant contracté des emprunts substantiels pour financer des investissements et un autre producteur dont la cessation de l’activité agricole était prévisible au moment de l’introduction des quotas? Allait-on compenser le faible niveau de production d’une exploitation dont le cheptel laitier avait été ravagé par une maladie contagieuse? Certaines dispositions dérogatoires étaient prévues à cet effet. Les exceptions autorisées dans le cadre du régime instauré il y a trente ans tendant à atténuer le caratère par trop rigoureux de certaines mesures ont donc pu être appliquées différemment d’un pays à l’autre. Autant la Commission était flexible sur les modalités d’exécution de la réglementation à l’échelle nationale, autant elle restait intransigeante pour ce qui était du payement des sanctions encourues en cas de dépassement du quota national.
Aussi importe-t-il de rappeler que l’introduction des quotas vers le milieu des années quatre-vingts visait avant tout à mettre fin à une situation devenue ingérable plutôt qu’à préparer le secteur laitier aux défis à venir. Cela n’a rien d’étonnant étant donné que la surproduction à l’échelle européenne avait pris entretemps des proportions telles qu’elles rendaient inéluctable la prise de décisions drastiques dans le secteur laitier.
En limitant la production laitière dès 1984, l’Union a, certes, réussi à geler le volume de production au niveau de chaque pays, mais elle n’a pas pu empêcher à la longue des développements très différents au niveau des exploitations individuelles selon qu’il s’agit de fermes laitières allemandes ou luxembourgeoises par exemple. Pour ce qui est de notre voisin allemand dont la production totale au plan fédéral était bon an mal an inférieure à la quantité autorisée par le régime des quotas, ses agriculteurs ou du moins nombre d’entre eux pouvaient produire autant qu’ils voulaient sans courir le moindre risque de sanction financière tant qu’il n’y avait pas d’excédent au plan national.
La règle était simple: quand le quotanational venait à être dépassé, les agriculteurs devaient s’acquitter d’un superprélèvement en fonction du dépassement de leur quota individuel. Par contre, dans un pays où le quota national n’était pas atteint, les agriculteurs ayant produit au-delà de leur quota individuel étaient excempts de toute pénalité. Ainsi, un agriculteur du Schleswig-Holstein avec un quota annuel de 300 000 kg de lait pouvait- il produire allègrement 500 000 ou un million de kg sans risquer la moindre sanction financière. Son collègue luxembourgeois ou néerlandais se trouvant exactement dans la même situation, mais ayant eu le malheur de produire le lait dans un Etat membre dépassant le quota national, encourait par contre des pénalités pouvant atteindre des dizaines de milliers d’Euros pour une seule année.
Fallait-il dès lors s’étonner de voir les producteurs allemands, ou du moins beaucoup d’entre eux, développer continuellement leur entreprise, accroître leur production et se mettre en ordre de marche pour relever les défis à venir de la production laitière après les quotas?
Il s’en suit qu’aujourd’hui les uns entament la période post quotas laitiers avec une bonne longueur d’avance sur les autres. Pour la plupart des producteurs de lait, cependant, c’est le début d’une période incertaine. Les fluctuations de prix vont s’accentuer au point de menacer dans leur existence-même les exploitations laitières les plus vulnérables. La concentration dans le secteur laitier va sans doute s’accélérer, le contraire serait d’ailleurs peu probable. Ne subsisteront que les exploitations les plus performantes, celles qui auront réussi à augmenter leur productivité plus que les autres. Les unes seront à même de vendre leurs produits partout dans le monde, les autres arriveront à peine à rester rentables en les vendant dans leur région. la survie des exploitations laitières dépendra de leur capacité de résister à des baisses de prix prolongées.
Lorsque les plus vulnérables auront disparu, la compétition opposera essentiellement des concurrents très habiles, familiers avec une logique globale de production et de commercialisation. Pour ceux-là, le marché mondial va être une référence incontournable à la fois pour leur approvisionnement en moyens de production et pour l’écoulement de leur production. Le lait qu’ils produiront résultera de la transformation par les vaches de fourrages grossiers produits dans leur ferme, de soja importé du Brésil ou des Etats-Unis, de maïs produit dans l’Union européenne ou à l’extérieur. Pour écouler toute leur production, ils seront tributaires de grands marchés solvables. Outre le marché européen ils vont devoir cibler des clientèles dans les pays émergents. S’il est encore prématuré de se lancer dans des spéculations sur l’avenir du secteur laitier, l’on peut affirmer dores et déjà que la compétition sera extrêmement dure.
Les petites et moyennes exploitations laitières seraient-elles dès lors vouées à la disparition? Pas nécessairement ou du moins pas dans leur totalité. La question est de savoir s’il est possible d’échapper au mainstream de la Politique Agricole Commune (PAC). La production de “lait biologique” est souvent avancée comme une alternative viable aux pratiques dites conventionnelles. Si tel était vraiment le cas, il y aurait lieu de s’interroger tout de même sur le peu d’empressement des agriculteurs à se lancer dans la filière biologique. Serait-ce une question de rentabilité? Peut-être. De mon point de vue, l’offre de lait biopourrait augmenter sensiblement si les agriculteurs pouvaient tabler sur un prix du litre de lait bio oscillant entre 0,45 et 0,55 Euro. Les chances de succès de cette politique seraient bien entendu fonction du nombre de consommateurs prêts à en accepter le coût. A ce prix vous aurez autant de lait bio que vous voulez. Une question de cohérence pour ainsi dire.
October 16th, 2014 by Charles Goerens
Ebola: nous sommes tous concernés!
Au mois de mars de cette année, EBOLA se manifeste pour la énième fois en Afrique subsaharienne. Jusque-là, chaque apparition du virus entraînant généralement la mort des personnes contaminées restait limitée à quelques rares cas. En principe, la presse ne devait y consacrer qu’une attention passagère pour voir EBOLA disparaître assez rapidement du journal de 20 heures.
Cette fois-ci, tout est différent. Depuis six mois, le virus progresse inexorablement en Afrique de l’Ouest. Toutes les trois semaines, le nombre de contaminations est multiplié par deux. Les pays disposant d’un système de santé très rudimentaire ont déjà perdu le contrôle de la maladie. Les centres d’isolement sont souvent saturés alors qu’on n’en est qu’au début de l’épidémie. De plus, les médecins et infirmiers, déjà trop peu nombreux au départ, atteints à leur tour par le virus, disparaissent à un rythme inquiétant.
Les malades qui viennent se présenter aux centres d’isolement sont souvent refoulés et vont, de surcroît, contaminer d’autres personnes. Entretemps le système de santé au Libéria est par terre, nous disent les humanitaires. Les morts se comptent par milliers et voir le nombre de personnes contaminées dépasser les dix mille n’est plus qu’une question de jours. Selon certaines projections, le million de victimes pourrait être atteint au printemps 2015. La croissance est devenue exponentielle. Conscients de la gravité de l’actuelle crise de l’EBOLA, les experts multiplient leurs appels à la mobilisation générale. À situation exceptionnelle, déploiement de moyens exceptionnels!
Une (ré)action vigoureuse est attendue depuis des mois. Au lieu de voir la communauté internationale prendre le taureau par les cornes, cette dernière donne l’impression de s’être d’abord installée dans la torpeur de l’été. Or, plus on diffère la mise en place d’un plan d’action approprié, plus l’exécution des mesures indispensables se fait attendre, moins il y a d’espoir de voir reculer EBOLA.
Pour ce faire, il faut être plus rapide que le virus! Qui doit faire quoi, quand et comment? Ou plutôt qui aurait dû agir quand et comment? Le temps perdu ne pouvant plus être rattrapé, il importe désormais de mettre les bouchées doubles et de consulter ceux qui, non seulement n’ont rien à se reprocher, mais qui, inlassablement, au risque de leur vie, sont actifs sur le terrain.
«Médecins sans frontières» ou les «French doctors», confrontés au quotidien à l’épidémie mènent un combat héroïque contre la maladie depuis des mois. C’est eux qui depuis le début du printemps ne cessent d’alerter l’opinion publique à propos de la catastrophe qui allait se développer sous leurs yeux. S’ils ne sont pas les seuls à s’être impliqués dans une lutte sans merci contre EBOLA, ils sont perçus, à raison, comme les acteurs pouvant nous renseigner au mieux sur le plan d’action à mettre en œuvre pour faire reculer ce fléau.
Apprenant à l’instant que d’aucuns, dans le microcosme bruxellois, se demandent s’il ne serait pas opportun de désigner un «Envoyé spécial EBOLA de l’Union européenne» pour les régions les plus touchées, on sera assez nombreux, espérons-le, à refuser à endosser une initiative qui ne contribue en aucune façon à endiguer le problème. Par contre, ce dont nous avons besoin, c’est d’un inventaire global actualisé en fonction des données sans cesse changeantes, faisant état des besoins urgents en matériel, en personnel médical, en termes de capacités de transport et de logistique.
Hélas, on est encore loin du compte. Ainsi, à ce jour, les États membres sont encore incapables de mettre en place une capacité d’évacuation des experts européens actifs dans la région une fois touchés par EBOLA. Cet aspect n’est pas sans importance, étant donné que les personnes pouvant s’impliquer dans le combat contre le virus seront peu disposées à partir pour la région en crise, si elles n’ont pas le moindre espoir de rapatriement une fois contaminées à leur tour. Un exemple parmi d’autres pour nous rappeler l’incapacité notoire des États membres de l’UE de coordonner leurs moyens.
Laissons de côté, pour l’instant, les mesures à prendre dans le long terme. Il importe désormais de mobiliser tous les moyens susceptibles de faire reculer le virus. Croire que la crise pourrait restée limitée à l’Afrique de l’Ouest est un leurre. La responsabilité de tous, et en premier lieu de l’Union européenne et de ses États membres, est engagée. «Si nous ne le faisons pas par altruisme, faisons-le au moins par intérêt». Cette citation de Louis Michel, ancien commissaire au développement, me paraît particulièrement pertinente dans le cadre de la présente crise.
July 8th, 2013 by Charles Goerens
Journée de la citoyenneté
Et pourtant il existe, le débat sur l’intégration européenne. Pour preuve, les quelque quatre cents personnes présentes à la Rockhal le dimanche, 30 juin 2013.
C’est dans le cadre de l’Année européenne du citoyen que la Commission européenne avait initié l’échange entre acteurs politiques et et représentants de la société civile. Pari réussi à en juger par la pertinence des questions posées et l’opportunité offerte aux acteurs politiques – habitués en règle générale à prêcher dans les salles désertes. La publicité qui a précédé l’événement, la répartition de l’auditoire en quatre blocs convergeant vers un plateau central réservé à la Vice-présidente de la Commission ainsi qu’au modérateur et à ses invités témoignent d’une organisation impeccable.
Quant au fond, le débat s’est concentré pour l’essentiel sur les libertés publiques, la dimension sociale de l’Union européenne et l’avenir de notre continent qui peine à sortir de la crise.
L’impression générale qui se dégage de ce débat est que l’heure n’est pas à la critique autodestructrice mais bien à l’introspection. L’examen de conscience doit porter sur la répartition des compétences entre les Etats membres et l’échelon européen. Façon imcomplète, toutefois, de poser le problème, étant donné que le fonctionnement des institutions européennes lui-même se trouve désormais au coeur du débat.
En effet, il n’est pas anondin de savoir qui, à l’avenir, aura vocation à faire bouger les lignes. Quel sera le rôle de la Commission? De quel poids pèseront les Etats membres dans les futurs mécanismes décisionnels? Les décisions relèveront-elles plutôt de la méthode intergouvernementale, au détriment des pouvoirs de la Commission de plus en plus marginalisée depuis le début de la crise? L’Europe pourra-t-elle encore se passer d’un vrai gouvernement économique, du moins pour l’Eurozone, ou va-t-on limiter le débat à un échange de quelques banalités sur la gouvernance de l’Eurogroupe?
Autre casse-tête, la dimension démocratique de l’Union. Plus elle devient intergouvernementale, moins elle est sujette à un contrôle démocratique. L’on a assisté au cours de ces dernières années à une augmentation des déficits démocratiques au sein de l’Union européenne. Si cette tendance devait se maintenir, des pans entiers de nos politiques risqueraient d’être éliminés du champ démocratique. Nombre de décisions arrêtées au niveau de l’Eurogroupe ont ceci de particulier qu’elles échappent à la fois au contrôle du Parlement européen et à celui des Etats membres. Autant de raisons qui nous invitent à poursuivre l’échange avec le citoyen.
A l’heure où les populismes, les nationalismes, les dynamiques d’exclusion et les égoïsmes de tout cran avancent sournoisement, l’approfondissement du dialogue avec le citoyen est la conditio sine qua non.
April 25th, 2013 by Charles Goerens
L’affaire Cahuzac
Sur l’affaire Cahuzac, presque tout a été dit mais pas encore par tout le monde. Retenons que toutes les conditions ont été réunies pour élever son délit de fraude fiscale au rang de drame absolu. Il y a d’abord la personnalité de Jérôme Cahuzac, la bête politique, le virtuose des bonnes pratiques budgétaires, acteur emblématique du parti socialiste “condamné” par les élections présidentielles et législatives de 2012 à inscrire la gestion des finances publiques dans la trajectoire du redressement.
Déjà amorcé par la majorité précédente, l’assainissement des finances publiques de la France est de nos jours devenu un objectif auquel souscrivent la plupart des partis politiques. Jérôme Cahuzac, dont le talent et la compétence forçaient le respect même de ses adversaires politiques, tirait tous les registres afin de réussir cette opération titanesque.
Rattrapé par son passé, ce sexagénaire bon teint, jusque-là habitué à la grandeur, se voit soudain voué à la vindicte populaire. En effet, il n’est pas sans intérêt de préciser que l’acte délictuel de fraude fiscale dont l’accuse entretemps la justice française est antérieur à son engagement politique. Pour rappel, c’est l’argent gagné en tant que chirurgien capillaire qui aurait alimenté son compte genevois. Si ce métier permet plus aisément d’amasser une fortune à l’insu du fisc -celui qui réussit à se faire regarnir le crâne ne s’en vante pas – cela n’en constitue pas pour autant une circonstance atténuante pour le prestataire de services qui s’est soustrait à son devoir de contribuable. De surcroît, le fait d’avoir nié devant l’Assemblée nationale l’existence de son compte en Suisse aggrave encore son cas.
Entretemps, les autorités de l’Hexagone, soit jouent les vierges effarouchées, soit se lancent dans un activisme aveugle dont il faut espérer qu’il sera de courte durée. En principe l’on devrait s’abstenir de définir une règle en fonction d’un problème conjoncturel. Le gouvernement français, cependant, ne semble pas avoir fait sienne cette maxime lorsqu’il a décidé de publier dans la hâte le patrimoine de tous ses ministres. A peine affichées, ces informations sont déjà sujettes à critique. Celles-ci sont de nature à satisfaire le voyeurisme plutôt que de garantir la probité des membres du Gouvernement.
Quand on arrête des positions dans la précipitation, on risque de perdre de vue des aspects essentiels dans le traitement d’une question. C’est ce qui semble arriver à un parti socialiste français désarçonné par l’Affaire. Dès les premiers aveux de Cahuzac, le PS a repris la croisade contre ce qu’il qualifie de paradis fiscaux dont notamment la Suisse et le Luxembourg. La Suisse, rappelons-le, ne s’est pas fait prier pour confirmer l’existence du compte de Jérôme Cahuzac. Quant au Luxembourg, il en aurait été de même si une banque de la place avait été dépositaire desdites économies. L’accord relatif à l’échange d’informations sur demande négocié entre la France et le Luxembourg il y a quelques années, aurait également permis de fournir aux responsables français les éléments de réponse appropriés.
Soit rappelé en passant qu’il y a plusieurs stades de lutte contre la fraude fiscale. Premier échelon: le sens civique du contribuable devrait être la règle. Il incombe ensuite au bureau d’imposition de juger de la crédibilité de la déclaration des assujettis à l’impôt. Cela ne devrait entamer en rien les possibilités d’investigation de l’autorité de contrôle fiscal. L’assomption pleine et entière des responsabilités par les acteurs respectifs, à chacun des trois niveaux précités, devrait en toute logique faire reculer la fraude. Plus efficace, mais moins spectaculaire.
March 21st, 2013 by Charles Goerens
La Syrie: risque assumé ou passivité coupable?
La guerre en Syrie entre dans sa troisième année. Depuis le début du conflit, pas une journée ne passe sans journaux télévisés relatant les pires atrocités. Les victimes, ayant payé de leur vie leur aspiration à un peu plus de liberté, se comptent par dizaines de milliers. Les personnes ayant fui la Syrie ainsi que celles déplacées à l’intérieur du pays dépassent déjà le million. Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’empathie ne croît pas avec le nombre de tués ou de blessés, qu’ils soient dix mille, soixante-dix mille ou un million et demi. Décidément, l’arithmétique des conflits ne prend plus, l’accoutumance à la barbarie, une fois de plus, finit par avoir raison de la compassion.
Vrais ou faux, les motifs avancés par la communauté internationale pour ne pas s’ingérer dans le conflit afin de mettre fin aux souffrances du peuple syrien ne manquent pas. Mentionnons d’abord le droit international, peu adapté aux conflits intra-nationaux, qui fait de la souveraineté nationale un bouclier protégeant le boucher de Damas contre toute intervention de nature à menacer son régime de terreur. S’y apparente la crainte de voir le conflit déboucher sur un embrasement de toute la région du Moyen-Orient. De ce fait la peur de l’apocalypse finit par condamner à l’inaction les puissances disposant des moyens de mettre en échec Bachar al Assad. C’est sur ces considérations que se fonde la thèse selon laquelle il n’y a pas de solution militaire au conflit.
Sur cette toile de fond de consensus mou et fort de la complicité de la Chine et de la Russie au Conseil de sécurité, Assad exploite sans le moindre scrupule la retenue de la communauté internationale pour condamner son peuple au silence. Il ne resterait donc plus que la recherche d’une solution politique à laquelle il ne semble pas y avoir d’alternative. Du déjà entendu, certes. Or, tant que cette solution n’est pas trouvée, les opposants au régime continuent à périrans l’indifférence générale.
Entretemps d’aucuns, dont notamment le Royaume-Uni et la France, soucieux de faire plier le régime Assad, plaident en faveur de la livraison d’armes aux forces rebelles. Le renforcement de la position des opposants, espèrent-ils, pourrait influer favorablement sur le cours des choses. En effet, des rebelles, militairement mieux équipés, pourraient aborder les phases ultérieures du conflit dans un rapport de forces qui leur serait plus favorable. Loin d’être hostile à un dénouement politique en Syrie, le Royaume-Uni et la France considèrent que la coalition anti-Assad aurait peu de chances de pouvoir s’imposer dans la négociation si elle devait y entrer en position de faiblesse.
Vouloir livrer des armes aux rebelles dans l’espoir de rendre un peu moins illusoire la fin de la barbarie en Syrie pourrait s’avérer une entreprise hasardeuse. Que l’Union européenne n’arrive pas à faire l’unanimité autour de cette idée n’a rien d’étonnant. Faut-il y voir seulement un clivage entre les belles âmes d’un côté et les va-t-en guerre de l’autre ? Vaclav Havel avait l’habitude de dire en pareille circonstance qu’il ne sert à rien d’attendre Godot parce que Godot n’existe pas. Faut-t-il dès lors dépasser le stade de l’inaction à laquelle les divergences des Vingt-sept viennent de condamner l’Union européenne et laisser les Britanniques et les Français agir en dehors du cadre européen? Oui, s’il n’y a plus d’autre espoir pour mettre fin au martyre du peuple syrien. De toute évidence, il n’y a jamais d’engagement sans risque.
February 14th, 2013 by Charles Goerens
L’inévitable crise budgétaire
L’espoir qu’avait fait naître le discours de François Hollande la veille du Conseil européen aura été de courte durée. En effet, les 7 et 8 février dernier, les vingt-sept chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE ont décidé de faire plafonner les dépenses de l’Union européenne à 960 milliards d’euros pour toute la période de 2014 à 2020. Ledit montant est nettement inférieur aux 1030 milliards d’euros consacrés à la période en cours et qui arrive à son terme fin 2013.
Si le Parlement européen n’a pas encore dit son dernier mot, il n’y a plus guère de doute sur le sort qu’il va réserver aux décisions du Conseil européen. En effet, les Ving-sept viennent de franchir une ligne rouge. Vouloir dépenser moins dans les sept années à venir dans le cadre du budget européen est perçu non seulement par le Parlement européen comme le degré zéro de la solidarité européenne face aux grands défis que sont la désindustrialisation et le chômage de masse mais également la perte d’influence de l’Europe dans le monde. L’Union européenne ne donne-t-elle pas par là même un signal d’abandon des grands chantiers de construction de notre avenir commun?
A vrai dire, l’incapacité de s’entendre sur un cadre financier pluriannuel digne de ce nom n’est que le reflet d’une crise plus profonde. Faut-il rappeler que, depuis qu’elle existe, les Etats membres privent l’Union européenne des moyens budgétaires nécessaires à la réalisation des objectifs qu’elle s’est elle-même fixés. Combien de fois va-t-il falloir rappeler que nombre d’initiatives produisent des résultats nettement meilleurs si elles sont concrétisées à travers le budget européen?
Nous serions dès lors confrontés uniquement à un problème de méthode, privilégiant le cadre décisionnel national? Tel serait le cas si les plus farouches opposants à une programmation financière européenne plus appropriée acceptaient de contribuer davantage à travers les budgets nationaux à la réalisation des grands objectifs politiques que sont notamment la croissance, l’emploi, la cohésion intérieure ainsi que la politique extérieure. Or, il est patent de constater l’incapacité des politiques nationales d’en arriver à bout de nos problèmes. En décidant de consacrer moins d’un pour cent du revenu national brut des vingt-sept Etats membres au budget de l’Union européenne, le Conseil européen rappelle à quel point l’Europe est devenue prisonnière du moins disant politique de plusieurs de ses composantes.
Avec un Parlement européen peu enclin à accepter un compromis au raz des pâquerettes, la crise semble devenir inévitable. Le rejet probable des décisions du Conseil européen par le Parlement fait courir cependant à ce dernier un risque non négligeable. En effet, des avancées réelles dans plusieurs domaines, dont notamment la Politique agricole commune, la politique de cohésion sans parler des programmes européens de recherche requièrent un minimum de prévisibilité. Sans cadre financier pluriannuel, l’indispensable planification à moyen terme deviendrait impensable, du fait de l’incapacité de l’Union de pouvoir s’engager au plan budgétaire au-delà d’une année. Le Conseil européen ne manquerait pas d’en faire endosser la responsabilité par le Parlement européen.
Si le Parlement européen veut sortir la tête haute de la présente crise, il aura besoin d’un allié solide, en l’occurrence la Commission, dont les propositions viennent d’être rejetées par le Conseil européen. La Commission pourra calmer le jeu en autorisant les Etats membres à proroger les programmes dans les domaines précités jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau cadre financier acceptable. C’est sans doute le seul moyen d’éviter que les personnes tributaires des politiques européennes ne soient pris en otage dans la querelle budgétaire qui met en opposition le Parlement européen et la Commission d’un côté et le Conseil européen de l’autre.
December 20th, 2012 by Charles Goerens
Morts pour rien?
La Nation américaine est en deuil. Ses citoyens, au moment de redécouvrir le calme et la sérénité de cette période de fin d’année sont secoués par la nouvelle d’une terrible tuerie. Massacre, barbarie, exécution deviennent des mots trop faibles pour exprimer ce que l’on ressent à propos de la fusillade de Newtown. Vingt-six personnes viennent de payer de leur vie le massacre perpétré par un jeune homme d’une vingtaine d’années. Pour six adultes, dont la mère du tueur, ainsi que vingt élèves de l’école locale, ce 15 décembre 2012 constitue leur disparition prématurée, la fin de leurs projets, de leurs attentes, de leurs rêves…
Le silence auquel ils sont désormais condamnés, contraste avec l’agitation médiatique qui entoure l’indicible événement. A l’ère de la communication instantanée, les objectifs de toutes les grandes chaînes de télévision sont braqués sur le lieu du crime. Dans les minutes qui suivent la tragédie, une petite ville est brutalement sortie de son anonymat. Newtown dont le commun des mortels n’avait jamais entendu parler, y compris aux Etats-Unis, devient du coup l’objet d’informations et de commentaires à n’en plus finir. Le micro en mains, des reporters font circuler les premiers messages. En évoquant le nombre de victimes, comparé à ceux d’autres tragédies, une brève description de la ville, quelques détails sur l’auteur du crime obtenus auprès de son entourage ou au bureau d’état civil de la municipalité, le reporter devient l’expert de ce coin perdu du globe comme s’il y vivait déjà dans la septième génération. Celui-ci se fait assez tôt relayer par un psychologue duquel on attend qu’il dresse un portrait du délinquant susceptible de nous renseigner sur les motifs de ce dernier. En mots pesés, avec suffisamment de précautions oratoires, celui qui est sensé lire dans l’âme des gens s’efforce à parler du tueur en veillant à ce que ses propos ne puissent en aucune façon être interprétés comme circonstances atténuantes.
En même temps, un débat, récurrent d’ailleurs, sur le régime très libéral d’accès aux armes à feu aux Etats-Unis, refait surface, comme toujours en pareille circonstance. Une loi plus restrictive en la matière serait-elle de nature à prévenir ce genre de dérive à l’avenir ? Peut-être pas dans le court terme car avec l’instauration d’un régime interdisant pour ainsi dire la vente d’armes et de munitions, le stock important de fusils, de révolvers et autres objets de tir ne disparaîtrait pas pour autant dans l’immédiat. Et pourtant cela pourrait déjà constituer l’indispensable premier pas dans la bonne direction. Telle est du moins l’opinion communément répandue dans la vieille Europe. Or, les coutumes, motivées par des réflexes culturels, relèvent des comportements les plus difficiles à changer. De plus, il faudrait passer par une modification de la Constitution américaine et se départir de l’amendement 2 qui consacre la liberté du port d’arme. Cette liberté a été confirmée d’ailleurs par l’arrêt de la Cour suprême en 2008 qui réaffirme que l’autodéfense est un élément central du droit. Du pain sur la planche pour un Obama qui ne court désormais plus le risque d’une non réélection et pourrait enfin s’attaquer à ce problème.[
L’agitation qui entoure ainsi la tuerie de Newtown ne se distingue guère de celle qui a marqué des catastrophes analogues. Rappelons-nous les événements, il ya dix-huit mois près d’Oslo où 70 jeunes ont été froidement exécutés. Même brassage médiatique. C’est très humain car tout le monde veut toujours tout savoir tout de suite. Loin de moi donc l’idée de vouloir imposer à la presse la manière de traiter ces événements. La question qui reste tout de même posée est celle de savoir quelle place on voudra bien réserver aux victimes dans notre mémoire collective. N’est-il pas consternant de constater qu’avec le recul, le seul nom qui nous revient sur les lèvres en évoquant le meurtre d’Oslo est celui du tueur ? En serions-nous arrivés à une sorte de fatalité qui consisterait à ne retenir comme élément personnel de tel événement que les nom et prénom de l’auteur du crime? Pas nécessairement. L’on pourrait s’inspirer de l’attitude adoptée par le Premier ministre de Norvège avait décidé de taire les coordonnées de l’auteur du crime et ce dès le début. A méditer ! En projetant l’image du délinquant en permanence sur nos écrans, on aboutit finalement à faire éclipser les victimes qui méritent que l’on se souvienne d’elles. Le bon exemple donné par le chef de gouvernement de Norvège n’a hélas pas été suivi dans son propre pays. A Newtown on est en train de refaire la même erreur. N’aurait-on donc rien appris?
November 22nd, 2012 by Charles Goerens
On est tous des Français en déficit
Après la pause estivale et l’embellie boursière, Moody’s vient de siffler la fin de la récréation en dégradant la note de la France. Ce qui, à vrai dire, n’a guère surpris. Malin, en revanche, celui qui nous dira de quoi l’avenir sera fait!
On y verra plus clair lorsque deux processus de décantation seront arrivés à leur terme. Celui inhérent au changement politique qui a porté François Hollande au pouvoir est déjà suffisamment avancé pour faire apparaître les contours de l’action politique qui marquera la vie des Français dans les mois à venir. La volonté de ramener le déficit du budget 2013 de 4,5 à 3% se traduira dans la plus grande cure de cheval jamais administrée à la société française depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une somme voisine de quarante milliards d’euros va devoir être mobilisée pour financer la réduction du déficit. La croissance économique n’étant pas au rendez-vous, il sera encore plus douloureux de trouver les moyens adéquats pour le financer.
A qui en incombe la faute? Aux responsables politiques de tous bords qui, au cours des trente dernières années, ont endossé des déficits budgétaires importants. Ce qui a fini par gonfler la dette souveraine de la France pour la porter au niveau de 65 % du Revenu national brut (RNB) avant la crise de 2008. De plus, les mesures de relance économique arrêtées par le gouvernement Sarkozy, ainsi que l’effet mécanique de la récession ont à leur tour aggravé le problème. Désormais le service de la dette est devenu le premier poste de dépenses budgétaires en volume. Tout le monde est conscient de l’enjeu existentiel posé par ce problème. Or, François Hollande avait promis de ramener le déficit à 3% en 2013. Bien naïf cependant celui qui croira que cette promesse se transformera en perspective réelle. Tous les observateurs de la scène politique française jugent intenable la promesse avancée par le Président.
L’autre processus de décantation, celui qui est en cours au sein de l’UMP, n’est pas aussi avancé. Et ce n’est pas la victoire à l’arraché de Jean-François Copé qui fera démentir nos propos. Défié sur sa droite par le Front national, d’une part et par le nouveau centre de Borloo, d’autre part, sans parler des querelles que se livrent depuis des mois les candidats à la présidence, l’UMP, qui n’est plus aux commandes après dix années de responsabilités exercées au sommet de l’Etat, est tentée de faire oublier qu’elle ne serait pas en mesure de ramener le déficit à 3 %.
Les déceptions, les frustrations, voire les règlements de compte que se livrent les perdants des scrutins de 2012 ont fini par brouiller l’image de ce parti. Plus signifiant: l’opinion publique, dépitée par le gouvernement Ayrault, ne crédite pas pour autant les ténors de l’opposition de la capacité de réussir là où vont sans doute échouer leurs successeurs.
Que faut-il retenir de ce constat? Premièrement, la classe politique, qu’elle soit de droite ou de gauche, est devenue esclave d’une promesse qu’elle ne peut pas honorer. À moins de vouloir balayer d’un revers de manche l’objection selon laquelle tout effort excessif de réduction du déficit pourrait s’avérer contreproductive, le bon sens plaiderait plutôt en faveur de la réalisation du même objectif mais échelonné sur deux ans.
Deuxièmement, la maîtrise des dépenses publiques et son impact sur la croissance, n’est pas qu’une affaire franco-française. Elle se trouve au cœur de la recherche d’une issue durable à la crise de l’Eurozone. Personne en Europe n’aurait intérêt à voir la France échouer dans ses efforts de redressement. Tout le monde souhaite voir la France garder intacte sa capacité d’emprunt à des taux raisonnables. La crédibilité du mécanisme européen de stabilité, au financement duquel la France contribue de façon décisive, en dépend particulièrement. Si en effet la France devait basculer dans le camp des récipiendaires des mécanismes de secours du type MSE (Mécanisme de stabilité européen), la confiance dans l’Euro se trouverait définitivement ébranlée.
C’est du dosage approprié de réduction des dépenses publiques, de mesures fiscales justes, mais aussi du rythme de leur mise en œuvre que dépendra le succès de l’opération d’assainissement des finances publiques. Le bon sens suggère donc de se hâter lentement sans rien céder sur la finalité.
Les deux candidats à la Présidentielle de 2012 auraient dû se réserver, ne fut-ce que cinq minutes, pour partager ce constat et s’accorder sur la finalité. Ce qui leur aurait permis de ne pas avancer des promesses irréalisables et éviter les lendemains qui déchantent. Démarche, certes inhabituelle, mais qui aurait été des plus salutaires, pour la France mais aussi pour l’Europe dans son ensemble.
October 25th, 2012 by Charles Goerens
L’Europe anoblie
En attribuant le Prix Nobel de la Paix à l’Union européenne, les membres de l’illustre Jury ont créé la surprise.
Cette décision surprend, au moins pour deux raisons.
D’un côté, le Jury n’a pas jugé opportun de retenir une personne méritoire capable d’influer de façon tout à fait exemplaire sur les relations entre hommes, respectivement entre Etats.
De l’autre côté, l’Union européenne devient récipiendaire du plus prestigieux prix décerné annuellement au moment où celle-ci vit les développements les plus dramatiques jamais rencontrés au cours de son histoire.
Reconnaissons-le, comparée à d’autres espaces économiques et/ou politiques, l’Union européenne est loin de se trouver dans une situation exécrable.
Ce qui inquiète, par contre, c’est la tendance, l’évolution dans laquelle s’inscrit son développement économique, social, voire politique. Son incapacité de faire naître des réponses durables aux problèmes de la dette souveraine de ses Etats membres de la zone Euro risque de l’entraîner dans des bouleversements sociaux de très grande ampleur qui pourraient mettre en cause la paix sociale et le modèle de gestion des conflits de l’Union européenne.
Les difficultés manifestes de nos élites – que sont les acteurs tant du Conseil que de la Commission – à en venir au bout de la crise actuelle, semblent avoir dissuadé les membres du Jury de décerner le Prix Nobel de la Paix à une personne engagée dans des responsabilités politiques au niveau de l’Union.
Qu’est-ce qui a donc bien pu les motiver dans leur décision?
A défaut de vouloir se prononcer sur un homme ou une femme aux mérites incontestables – il doit y en avoir – en matière d’intégration européenne, ils ont retenu un groupe de 27 pays unis par un ensemble de textes précisant les pouvoirs et compétences d’une entité politique en quête de projet. Cette grande “inachevée” qu’est l’Union européenne, et c’est fort regrettable, se met à balbutier sinon dans toutes ses 23 langues officielles, du moins dans un Anglais souvent très approximatif dès qu’on l’interroge sur son projet, sur son degré d’intégration, sur son indispensable capacité à se démocratiser…
Pour rester dans le domaine de la spéculation, pourquoi ne soupçonnerait-on pas les membres du Comité Nobel de s’être laissé guider par des arrière-pensées? Il est difficile d’évoquer cette hypothèse, étant donné que les institutions scandinaves sont en général des temples de la transparence. Mais on ne peut pas l’exclure a priori.
Le Jury du Prix Nobel aurait-il donc plutôt décerné son prix à cet idéal européen toujours ambitionné? Il est vrai, la crise de confiance qui s’aggrave entre les élites et les citoyens européens constitue un danger tel pour notre continent que c’est l’idéal visé par la construction européenne, plutôt que l’Union dans son état actuel, qui puisse garantir à l’avenir la pacification durable de notre continent.
A l’heure de la communication instantanée, et au regard de leur silence relatif sur cet aspect, les membres du Jury me pardonneront de leur prêter les arrière-pensées les plus nobles.
September 13th, 2012 by Charles Goerens
Yves Mersch: quelle issue?
Le Traité sur l’Union européenne, signé à Lisbonne, stipule dans son article 2 que “L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes.”
Cette disposition constitue à la fois un aboutissement et un point de départ. Aboutissement car il aura fallu déployer des efforts considérables pour élever la non- discrimination basée sur l’origine ethnique, la religion, le sexe ou la nationalité au rang de principe quasi constitutionnel à l’échelle européenne. Point de départ également car pour les faire respecter à la même échelle, les principes doivent être traduits en textes législatifs, prévoyant des sanctions en cas de non-respect. Ce vaste projet est loin d’être terminé.
C’est ainsi que la construction européenne, basée sur un socle de valeurs fondamentales, a le mérite de mettre fin progressivement à des injustices qui trouvent leur origine dans la nuit des temps.
Venons-en maintenant à la proposition de nomination d’Yves Mersch au directoire de la Banque centrale européenne. Pour qu’il n’y ait pas le moindre malentendu à ce sujet, les compétences de ce candidat luxembourgeois ne sont mises en doute par personne. Ajoutons que sa nomination, au cas où elle deviendrait effective, ne serait non seulement légale mais également légitime.
Où se trouve donc le problème?
Yves Mersch, comme le prévoient les arrangements interinstitutionnels, aurait dû subir l’épreuve d’une audition organisée par la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Après l’avoir annoncée, le PE en a décidé autrement et a, de ce fait, empêché la procédure d’aboutir.
Les coordinateurs – représentants des groupes politiques – de la Commission des affaires économiques et monétaires motivent leur blocage en recourant à l’argument qu’avec la nomination d’Yves Mersch – sauf incident de parcours – le directoire de la BCE ne comprendra pas une seule femme jusqu’en 2018: une situation contraire à l’esprit du Traité mais conforme à la lettre.
Du seul point de vue juridique, Mersch pourrait accéder à sa nouvelle fonction sans tenir compte des objections de la Commission des affaires économiques et monétaires. Cette hypothèse est cependant peu réaliste.
Sauf à vouloir envenimer durablement les relations interinstitutionnelles entre le Parlement européen et le Conseil, ce “passer outre” aurait des conséquences fâcheuses pour leurs relations futures.
Comment sortir de l’impasse?
La solution pourrait consister à explorer les pistes d’un compromis mettant un terme à la logique du “tout ou rien”.
L’on pourrait par exemple transcender la situation conflictuelle actuelle en essayant de répondre aux exigences du PE en matière de participation des femmes à de hautes responsabilités dans un cadre plus large. Pourquoi d’ailleurs se limiterait-on aux six postes du directoire de la BCE? Le pôle économique et monétaire de l’UE comprend bien d’autres institutions et notamment le Mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d’investissement, la Surveillance bancaire…
Au regard des difficultés qui secouent l’Union européenne dans ses fondements mêmes, il serait bien dommage de laisser cette piste-là inexplorée.
Le pire serait d’assister impuissamment à un durcissement des positions que nombre de citoyens auraient de la peine à comprendre.
Nous pouvons et nous devons d’ailleurs mieux faire. L’on pourrait s’imaginer ainsi que les responsables des institutions précitées ouvrent plusieurs postes à haute responsabilité à des candidats féminins.
Ce qui nous assurerait une sortie honorable de ce différend institutionnel. Et constituerait un progrès sur le fond d’une question qui relève de nos valeurs.
July 12th, 2012 by Charles Goerens
Le rendez-vous de Cinqfontaines
L’endroit est bien caché. A la sortie de Clervaux, on passe par Maulusmuehle pour se diriger vers Sassel. Après avoir quitté le village, un chemin étroit vous mène sur la hauteur et c’est là que ça se complique. Le dimanche matin vous ne rencontrez personne sur ce plateau. Pas la peine d’interroger le navigateur, il restera muet. Au milieu des champs, il faut donc prendre une direction au hasard. En pareille circonstance, le premier choix n’est pas nécessairement le bon. Après plusieurs essais, on se dit que l’on pourrait y arriver aussi avec un brin de logique: l’endroit recherché devrait se situer à l’abri des regards et à proximité du chemin de fer, lui-même situé dans la vallée. Il faut donc s’engager dans la descente, traverser une petite forêt de conifères pour découvrir finalement une voie étroite au bout de laquelle se situe Cinqfontaines. C’est cette logique – discrétion et proximité d’un moyen de transport de masse – qui avait été à l’origine de la recherche de ce site par les nazis au début des années quarante.
En ce dimanche, 1er juillet, comme tous les ans, les Juifs du Luxembourg se donnent rendez-vous dans ce coin perdu des Ardennes. Ils sont venus nombreux pour raviver le souvenir de l’événement le plus sombre de leur Histoire.
Le regretté Paul Cerf, dans son livre qui fait date «L’étoile juive au Luxembourg», nous rappelle qu’en «attendant que le Luxembourg soit complètement “judenrein”, les Allemands veulent concentrer tous les Juifs dans un ghetto, à l’instar de ceux qui existent dans le Generalgouvernement». L’auteur souligne, par ailleurs, «que le Grand-Duché fût le premier pays occupé de l’Europe de l’Ouest où les Allemands introduisirent la législation raciale et antijuive en vigueur dans le Reich hitlérien depuis 1935: dès le 7 août 1940, le rideau de la terreur s’abattit sur la petite communauté juive du Luxembourg. Un tiers des Juifs du Luxembourg furent anéantis au cours de la Seconde Guerre Mondiale.»
En plein milieu de la cérémonie organisée à la mémoire des quelque 700 membres de leur communauté déportés à partir de Cinqfontaines, le passage d’un train rend inaudible les paroles d’un discours prononcé à cette occasion. Pas besoin de le voir, il suffit d’entendre le bruit du train pour savoir que la voie ferrée est tout proche. A l’issue de la partie officielle de l’événement, d’aucuns parmi les participants ne manquent pas de rappeler que ce bruit leur donne des frissons encore soixante-dix ans après. Les voilà replongés dans le contexte des années 1940.
Le monde a profondément changé, mais pour ce qui est des moyens techniques auxquels ont recouru les nazis à l’époque, ceux-ci ont bien résisté au temps. Ainsi, la logistique de transport de masse, loin d’avoir disparu, assure de nos jours, de façon de plus en plus performante, la mobilité de nos contemporains. Quant aux moyens de propagande déployés dans le cadre de l’incitation à la haine contre les juifs, ils n’ont rien perdu de leurs potentialités, bien au contraire.
Il en est de même des capacités administratives de nos Etats. Plus rien n’échappe désormais à l’emprise d’archivage digitalisé que les mesures de protection de la vie privée n’arrivent plus guère à endiguer. Rappelons-nous que le fichage systématique des juifs il y a trois générations, bien que très décisif dans l’identification de tous les membres de leur communauté, ne revêtait encore, pour ainsi dire qu’une dimension artisanale. C’est dire que le crime d’Etat au début du vingt-et-unième siècle pourrait se perpétrer par des moyens autrement puissants.
Le lendemain, en tenant dans mes mains le livre de Georges Bensoussan intitulé « Auschwitz en héritage? », je tombe par hasard sur une phrase écrite par l’idéologue allemand Paul de Lagarde vers la fin du dix-neuvième siècle: « Avec les trichines et les bacilles, on ne négocie pas, et ni trichines ni bacilles ne sont susceptibles d’être éduqués; on les extermine aussi rapidement et aussi complètement que possible. » Pour Paul de Lagarde, le juif n’était plus que « bacille » et « souillure ». Les moyens précités auquel il y a lieu d’ajouter le ZYKLON B, un Etat hyper-organisé, des citoyens ne s’opposant plus à la progressive déshumanisation de la population juive ont contribué à ce que les propos de Lagarde devinrent triste réalité.
May 16th, 2012 by Charles Goerens
L’Etat de Grèce
De nos jours, l’absence prolongée d’un parti politique de l’exercice gouvernemental semble constituer le meilleur atout dans la (re)conquête du pouvoir. Après les changements politiques en Irlande, au Portugal et en Espagne, les élections en France et en Grèce confortent ce constat. Depuis le début de la crise en 2007, les citoyens se mobilisent un peu partout pour le rejet des partis qui ont gouverné leur pays. Ce vote sanction les frappe indistinctement de leur positionnement sur l’échiquier politique.
Autre tendance: malgré le caractère national du scrutin dans les pays précités, l’enjeu de toutes ces élections est aussi clairement européen. Appelés à désigner leur futur dirigeant, les citoyens se prononcent avant tout contre la politique des sortants en sanctionnant leur bilan et moins sur une orientation claire susceptible d’indiquer la voie de sortie de la crise des prétendants au pouvoir.
Ralentissement de la croissance par ci, stagnation, voire récession par là, une relance keynésienne s’avère être, à tout le moins, très improbable, vu que les moyens budgétaires ont déjà été rongés par la réponse donnée à la crise bancaire déclenchée par la faillite de la Banque de Lehman Brothers en 2008. Le Traité intergouvernemental, quant à lui, imposé sous la férule de la chancelière Merkel, comme le perçoivent nombre de nos concitoyens, fait l’objet d’une opposition croissante qui balaie sur son chemin tous ceux qui semblent y souscrire.
A vrai dire, l’on ne sait pas trop s’il faut éprouver de la compassion pour ceux qui viennent de perdre le pouvoir ou plutôt pour ceux qui viennent d’y accéder. Ainsi, François Hollande, vainqueur des présidentielles françaises, au lendemain d’un parcours électoral sans faute, voit-il se cristalliser sur sa personne les attentes de tous ceux qui n’en peuvent plus et qui le poussent à mettre un terme à l’austérité budgétaire.
Le fait d’avoir profité d’une vague de rejet de la personne de Nicolas Sarkozy lui a permis de rester peu concret dans ses engagements vis-à-vis du peuple français. Mais, désormais, il ne pourra plus longtemps rester évasif sur la façon dont il entend doper la croissance sans abandonner l’objectif d’assainissement des finances publiques de l’Hexagone (en déséquilibre d’ailleurs depuis 1974). Toutefois, s’imaginer un seul instant François Hollande sous-estimer les difficultés qui l’attendent dès les premiers jours de sa prise de fonction, serait méconnaître les talents de cet habile tacticien corrézien.
Le nouveau Président sait qu’il n’aura pas droit à un seul moment de répit dans les réponses qu’attendent les Français.
En effet, cette crise, qui balaie tout sur son chemin, aura également eu raison des cent jours de retenue que s’imposent traditionnellement les adversaires politiques, ainsi que la presse dans leur appréciation du nouveau Président.
Qualifiés généralement d’Etat de grâce, ces cent jours ont donné lieu, dans un récent commentaire de Michel Rocard, à un joli petit lapsus qui en dit long sur les problèmes que va devoir affronter François Hollande. L’ancien Premier ministre de François Mitterrand aurait, en effet, parlé d’Etat de Grèce en faisant allusion aux responsabilités qui attendent son camarade Hollande. Bref, ce lapsus nous rappelle que le résultat d’une autre élection, en Grèce cette fois-ci, constitue un véritable casse-tête pour le nouveau chef d’Etat français.
Les autorités gouvernementales des Etats membres de l’Eurozone vont devoir déployer tous leurs talents politiques et diplomatiques pour convaincre les responsables politiques à Athènes que l’issue à la crise que traverse leur pays passe par le respect de la parole donnée.
Dans sa nouvelle fonction de membre du Conseil européen, responsable en dernier ressort de ce dossier, il n’y a décidément plus le temps pour les rêveries et les envolées lyriques.
April 19th, 2012 by Charles Goerens
La Chine: un pays en développement?
La Chine, première puissance exportatrice du monde, pourra-t-elle encore bénéficier, à l’avenir,de l’Aide publique au développement (APD)? La Commission européenne vient de mettre un terme à cette interrogation en déclarant vouloir biffer de la liste des bénéficiaires de son APD non seulement la Chine, mais également l’Inde et le Brésil, entre autres. Elle l’a annoncé dans le cadre de son programme pour le changement (“Agenda for Change”) qui précise les lignes directrices de l’UE dans ses relations avec les pays en développement.
Les changements en profondeur, qui secouent le monde depuis les années 1990, confirment la justesse des vues de la Commission. Peut-on, en effet, ignorer que le centre de gravité du monde économique est en train de se déplacer des pays à économie mature vers les pays encore émergents ou déjà émergés. Rappelons qu’à l’origine de ce phénomène se trouve la mondialisation qui, d’une part réduit les inégalités entre les Etats et, de l’autre, les accroît à l’intérieur des nations, qu’elles soient riches ou pauvres.
La lutte contre la pauvreté dans un pays qui s’enrichit, dont l’économie dégage de plus en plus de ressources, devient, dès lors, la responsabilité première de ses autorités politiques. Il incombe donc à la Chine, au Brésil, à l’Inde, au Pérou, et à bien d’autres, de consacrer une part croissante de leur revenu à leurs citoyens en détresse.
L’éradication de la misère matérielle relève, de ce fait, de la politique intérieure de leur pays plutôt que de la solidarité internationale.
L’UE pourra ainsi consacrer son Aide publique au développement aux pays en développement qui en ont le plus besoin, et, parmi eux, le groupe des pays les moins avancés (PMA). Le programme pour le changement de l’UE va contribuer, de ce fait, à la responsabilisation de tous les Etats en matière de lutte contre la pauvreté à l’horizon 2015. Or, le plus grand nombre de pauvres meurt dans les pays à revenu intermédiaire. Désormais, le sort des pauvres dans ces pays va être lié davantage à la capacité de redistribution des moyens de leur pays que de l’aide extérieure.
Autre accent du programme pour le changement: la croissance inclusive. La Commission insiste, à raison, sur le rôle du développement économique comme générateur potentiel de progrès social. A cette fin, la promotion des activités économiques dans les pays en développement partenaires de l’UE deviendrait éligible au titre d’aide publique au développement.
D’aucuns redoutent cependant la probabilité de voir les moyens réservés, le cas échéant, à la croissance inclusive servir à des fins autres que la lutte contre la pauvreté. En raison de ce risque, il peut paraître judicieux de prévoir des garde-fous. En effet, tout projet consacrant des moyens importants à la croissance inclusive devrait faire l’objet d’une évaluation destinée à nous renseigner sur son impact réel en termes de réduction de la pauvreté. Toutefois, s’agissant des pays en développement, les personnes les plus pauvres y trouvent, pour la plupart d’entre elles, leurs moyens de subsistance dans ce qu’il est convenu d’appeler “l’économie informelle”. La croissance inclusive ne pourra donc en aucun cas faire l’impasse sur cette particularité qui est loin d’être marginale.
Le double constat ci-dessus nous rappelle la nécessité de progresser en matière de cohérence de toutes les politiques de l’UE. Cela veut dire que l’on devrait veiller à ne pas détruire, par les moyens mobilisés dans un domaine, un projet élaboré dans un autre domaine politique.
March 8th, 2012 by Charles Goerens
La «démocrature hongroise»
Les nationalismes et populismes ne cessent d’influer sur le débat européen. A peine trois semaines après le lancement de son site internet destiné à recueillir des critiques à l’endroit des immigrés de l’est de l’Europe, le populiste néerlandais Geert Wilders a lancé, cette semaine, un pavé dans la mare en présentant une étude (faite sur mesure par une agence londonienne ouvertement eurosceptique) sur les méfaits de l’euro. Par ailleurs, l’apprenti-sorcier hongrois, Victor Orban, continue, de son côté, à défrayer la chronique.
En effet, avec sa manière de flatter le sentiment nationaliste magyar depuis deux ans, le gouvernement de Victor Orban se serait disqualifié en tant que pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne en 2004. Disposant d’une majorité parlementaire des deux tiers, son parti n’hésite pas à reformuler, à sa guise, les dispositions constitutionnelles sur la liberté de la presse. Par ailleurs, en baissant l’âge de la retraite pour les juges de 70 à 62 ans, Victor Orban a trouvé le moyen de se débarrasser des magistrats qui pourraient lui être gênants. Cependant, le Premier ministre hongrois ne se laisse guère impressionner par les mises en garde de l’UE. Dans un premier temps, il accepte de porter quelques modifications de façade à sa législation avant de préparer son prochain coup. Sa tentative de porter atteinte à l’indépendance de la Banque centrale de son pays n’en est qu’une ultime illustration.
Il est clair que, suite aux agissements du Gouvernement Orban, la Hongrie s’est écartée et de l’esprit et de la lettre des critères de Copenhague. C’est pourquoi la Commission européenne a engagé trois procédures d’infraction contre le pays dont l’issue est encore incertaine.
Pour les institutions européennes, le cas hongrois constitue désormais un vrai test de crédibilité. En effet, le Traité de l’UE prévoit dans son article 7 de pouvoir suspendre le droit de vote d’un Etat membre en cas de violation grave des valeurs fondamentales, telles que définies dans l’article 2 du Traité de Lisbonne relatives à la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’Etat de droit et au respect des droits de l’Homme. Ajoutons qu’il ne suffit pas de constater les atteintes auxdites valeurs, encore faut-il que les Etats membres votent les sanctions prévues par le Traité.
Aussi, lors de son intervention au sein du Parlement européen le 18 janvier, Victor Orban, a-t-il, non sans habilité, essayé de diviser les groupes politiques du Parlement européen dans le cadre de la discussion portant sur la conformité de l’action de son gouvernement à la législation européenne.
Pour être crédible, la riposte de l’UE devrait se situer à deux niveaux, l’un politique, l’autre juridique. Quant au plan juridique, les procédures prévoient des délais qui sont parfois tels qu’ils peuvent faire douter l’opinion publique de la volonté de la Commission d’aller de l’avant. Il serait judicieux, dès lors, de sortir du piège de l’inaction auquel la lenteur de la démarche de la Commission semble nous avoir condamnés et d’explorer des possibilités de riposte plus rapides et complémentaires à celles déjà existantes. De ce point de vue, rien ne devrait empêcher l’Agence des droits fondamentaux de Vienne de s’exprimer dans un délai plus rapproché sur la question de savoir si un Etat membre agit encore en conformité avec le droit européen et les engagements pris au moment de son adhésion à l’UE. Finalement, grâce à l’implication de l’Agence de Vienne, la sphère politique ne pourrait plus prétexter d’aspects procéduraux pour se dispenser de prendre position face aux agissements inacceptables d’un Etat membre au regard des valeurs inaliénables qui constituent le fondement même de la construction européenne.
Il importe de rester vigilant en matière de respect des droits fondamentaux. Les autorités hongroises pourraient considérer l’appartenance à l’Union européenne comme contraire aux aspirations du peuple hongrois. Si tel était bien le cas, Victor Orban devrait expliquer à son peuple que celui-ci avait fait le mauvais choix en décidant en 2004 d’adhérer à une Union basée sur des valeurs fondamentales de libertés et de droit et en tirer toutes les conséquences.
February 16th, 2012 by Charles Goerens
Ad ACTA?
C’est ainsi depuis la nuit des temps: la communication orale est libre, son contenu se perd à la vitesse où il s’articule. Même pour des échanges plus élaborés, recourant à des références littéraires, scientifiques ou artistiques, la conversation est toujours d’une certaine façon purement gratuite. Et ce au double sens du terme: elle ne coûte rien et, par ailleurs, elle n’expose pas son ou ses auteurs à des contrôles susceptibles d’entraîner des poursuites judiciaires. Nos sociétés auraient d’ailleurs l’air très triste si elles ne disposaient pas de cet espace de liberté et d’expression démocratique.
La communication changerait-elle de nature dès lors qu’elle serait assurée par des moyens électroniques? A en croire les détracteurs de l’accord ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) ou ACA (Accord Commercial Anti-Contrefaçon), nous serions sur le point de franchir cette ligne rouge. L’agitation de la société civile autour de cet accord a pris une tournure qui envahit désormais la sphère politique. Ceux qui avaient déjà entonnés le requiem pour une jeunesse trop passive, absente du débat public, cette fois-ci, en prennent pour leur grade.
Pour les jeunes, la communication électronique via internet, une fois l’accord ACTA en vigueur, donnerait un caractère différent à la communication. Du fait de la digitalisation, l’information voyage par voie électronique entre l’auteur et son/ses destinataire(s). La transmission de ces messages est assurée par des serveurs puissants. Quiconque a accès au serveur peut lire dans l’âme des gens et en exploiter le contenu. A moins de pouvoir prévenir toute possibilité d’abus par des règles strictes et efficaces.
En toute logique, les dispositions légales sur lesquelles se basent les règles de protection applicables au traitement des données électroniques sont les mêmes qui fondent les dérogations ou exceptions au régime commun. Tout dispositif réglementaire en la matière doit rester conforme aux principes de proportionnalité et de confidentialité des données pour n’évoquer que les précautions les plus élémentaires à prendre dans ce domaine. Le projet ACTA, va-t-il mettre fin au régime de relative tolérance applicable jusque-là à l’utilisation du net? Va-t-on assister, comme le laissent entendre les opposants d’ACTA, à la violation systématique de la sphère privée des internautes au seul motif que la protection de la propriété intellectuelle n’aurait pas d’autres moyens de contrôle de la contrefaçon que l’incursion dans internet? Chaque mouvement sur internet serait-il désormais perçu comme une violation potentielle de la protection de la propriété intellectuelle?
Une future «police d’internet», va-t-elle désormais voir dans chaque mouvement sur le net une infraction potentielle au régime anti-contrefaçon? Les détracteurs de l’accord ACTA le redoutent. Les pays signataires, par contre, réfutent cette affirmation avec la même détermination. Or, de deux choses l’une: ou bien les craintes des jeunes qui défendent jalousement leur statut d’internautes libres sont justifiées ou bien elles ne le sont pas.
C’est au Parlement européen de faire en sorte que les réponses à l’ensemble des questions en suspens soient fournies avant de voter sur le texte de l’accord. C’est dans le cadre de l’audition prévue pour le 1er mars que l’on peut s’attendre aux premiers éléments de réponse aux craintes manifestées avec vigueur le weekend dernier.
Si des malentendus peuvent être levés grâce à l’intervention de la Cours de Justice Européenne, il faudra explorer cette piste! Si, toutefois, des craintes justifiées devaient se maintenir, malgré la bonne foi de tous les participants à l’examen de l’accord – ce qui me semble être la moindre des choses – les signataires d’ACTA devraient arrêter le processus de ratification. Si l’on veut que les rapports intergénérationnels s’inscrivent dans un climat de confiance, on ne pourra pas faire l’économie d’un échange ouvert, franc et direct.
January 19th, 2012 by Charles Goerens
SUBIR OU AGIR?
2012 va être une année décisive à la fois pour les Français et les Américains. Outre les choix cruciaux de politique économique et sociale, qui s’imposent en cette période de crise, les électeurs des deux pays auront à se prononcer sur leur future direction politique.
Chacun de ces processus démocratiques sera lourd de conséquences pour l’Union européenne, dont le centre de gravité politique tend à se déplacer de plus en plus vers Berlin. C’est, en effet, à Berlin que se préparent les grandes orientations pour la zone Euro.
Berlin a été à l’origine du projet d’Accord intergouvernemental actuellement en discussion. C’est à Berlin que le coup de grâce vient d’être donné à l’intégration européenne, telle que conçue par Helmut Kohl.
Serions-nous dès lors confrontés à un nouveau rapport de forces à l’intérieur de l’Union européenne?
Assurément oui, puisque plus rien ne semble désormais freiner les ardeurs d’une Allemagne habituée à des performances économiques très enviables, dans sa volonté d’adopter une posture politique plus robuste.
Le contraste avec l’Allemagne de l’après-guerre, souffrant d’un complexe d’infériorité, est patent.
Toutefois, la RFA paraît d’autant plus forte que ses partenaires continuent à s’enliser dans la difficulté, ce qui est notamment le cas pour la France. C’est sur cette toile de fond que l’élection présidentielle dans l’Hexagone prend toute son importance.
Le Président qui sortira des urnes, d’ici quelques mois, devra avoir l’autorité suffisante pour signaler à l’Allemagne que les Français n’accepteront plus d’être marginalisés dans le cadre des rapports franco-allemands. Il faut l’espérer. Ce qui donnerait, par ailleurs, aux Français l’opportunité de s’exprimer au nom de tous les Européens soucieux de ne plus voir leurs chefs d’Etat et de gouvernement condamnés à subir le diktat d’outre-Rhin?
Pour être clair, les candidats à l’élection présidentielle pèseront d’autant plus lourdement, tant en France qu’en Europe, qu’ils seront à même de répondre aux attentes de tous les Européens. Et de contribuer ainsi à mettre en place une gouvernance garante à la fois d’un système décisionnel efficace, sans toutefois heurter le principe d’égalité statutaire de tous les Etats membres.
Pour ce qui est de l’élection du Président des Etats-Unis, si celle-ci relève, bien entendu, de la responsabilité des citoyens américains, elle nous concerne également. Ainsi, bien avant l’élection proprement dite, nombre de décisions concernant les affaires du monde sont-elles reportées à plus tard. L’on perçoit déjà, dix mois avant l’échéance, cet effet paralysant qui caractérise en général les périodes préélectorales aux Etats-Unis.
De plus, entre le 6 novembre 2012, jour de l’élection, et le 20 janvier 2013, date de l’investiture du nouveau Président des Etats-Unis, ce dernier donne la priorité à la constitution de sa nouvelle administration; s’y ajoutent les cent premiers jours de la nouvelle équipe, qui jouit, de ce fait, d’une sorte d’état de grâce. Nous voilà déjà arrivés au mois de mai 2013. Serions-nous dès lors réduits au rôle de simple observateur en attendant la fin de la période de rodage à Washington?
Ne tablons pas sur la fatalité! L’Union européenne, qui aspire à devenir un acteur global, serait bien inspirée de profiter de cette période de 15 mois pour faire part aux candidats à l’élection présidentielle d’abord, et au Président élu ensuite, des vues de l’Union sur les grands thèmes que sont les relations transatlantiques, le changement climatique, la crise économique, les relations avec les pays en développement…
Pour une Europe qui, au fil des ans, a fini par accepter le leadership américain dans nombre de domaines, s’agirait-il d’une initiative d’ores et déjà vouée à l’échec? Pas nécessairement. Il faut oser. Cela ne pourra se faire cependant que si l’Union européenne arrive à définir des positions claires sur les grands sujets d’intérêt commun. A cette fin, elle serait bien inspirée de recourir de nouveau à la méthode communautaire. Les termes du choix sont bien clairs: partager un peu plus de souveraineté et peser davantage dans un monde marqué par la globalisation ou accepter de se priver de toute possibilité d’influer sur le cours de choses. Pourquoi devrait-on se priver d’une opportunité d’agir à un moment où les décisions ne sont pas encore prises? L’alternative consisterait tout simplement à accepter le fait accompli.
November 17th, 2011 by Charles Goerens
L’Europe, ça s’explique!
“Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose… Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer.” Antoine de Saint-Exupéry
Calme ou agitée, la mer est symbole à la fois de toutes les opportunités et de tous les dangers. Elle est source de vie, nous procure de la nourriture, elle relie entre eux des continents, mais une fois déchaînée, elle peut déployer des forces qui dépassent notre imaginaire. L’on ne peut pas se soustraire à ses caprices sans se priver par là même des bienfaits de sa générosité. Face à elle, nous devenons conscients de nos limites. Face à elle nous découvrons aussi nos possibilités.
Notre bonne vieille Europe serait-elle si différente de la mer ? Théâtre de tous les dangers, l’Histoire de notre continent nous rappelle que certains courants ont enterré sous eux des peuples entiers. La même Histoire nous enseigne aussi que, une fois le calme retrouvé, la même Europe peut redevenir source de richesses tant matérielles que culturelles à condition de les accepter, de voir dans leur diversité une chance plutôt qu’un obstacle. De 1933 à 1945, cette Europe nous a fait découvrir nos limites, notre impuissance face aux vagues de populismes, aux poussées nationalistes. Et finalement, le tsunami nazi a failli avoir raison de tout ce que les peuples européens ont su donner à la civilisation.
Si les années 30 nous ont indiqué nos limites, Jean Monnet n’a pas tardé à nous faire découvrir nos possibilités dès la fin de la seconde guerre mondiale. Conscient de la vulnérabilité du vieux continent, il avait compris que les lignes Maginot avaient fait leur temps et qu’il fallait désormais renoncer à se réfugier derrière de fausses protections. Sa méthode a permis aux Européens de se nourrir, de renouer avec la prospérité, de prévenir le retour des luttes ancestrales. Sa méthode a eu un prix : un abandon de souveraineté de la part des Etats qui ont accepté de participer à l’œuvre collective. En revanche, ces derniers ont vu L’Allemagne mettre fin à son « Sonderweg »
Pour les Européens, la stabilité monétaire correspond au calme en haute mer. En effet, c’est en ces périodes d’absence de turbulences que le navire dont sont copropriétaires les 17 Etats membres de l’Eurozone peut faire les plus grandes avancées vers les rives lointaines. Quant à savoir si ledit navire est bien conçu pour résister aux vagues fouettées par les vents déchaînés du grand large, il faut attendre les grandes tempêtes. Comme celles-ci se multiplient à une cadence très inquiétante depuis le déclenchement de la crise de 2008, les occasions pour tester la résistance du navire n’ont pas manqué.
Les innombrables faiblesses, voire même les vices de construction du navire « Eurozone » n’ont pas tardé à se manifester. Les passagers s’interrogent sur l’étanchéité du métal tant les parties grecques et italiennes sont déjà entamées par la corrosion.
Le fait que la partie allemande dispose d’une double coque ne va pas mettre fin à la spéculation contre l’« Eurozone » menacée de naufrage.
Il n’est dès lors pas étonnant de voir l’« Eurozone » rentrer régulièrement au chantier naval à des fins de réparation. Une fois les travaux terminés, il regagne la mer pour une destination inconnue. Comment voulez-vous d’ailleurs fixer le cap si vous ne pouvez pas identifier le capitaine?
En réalité, il y a trop de capitaines qui veulent, chacun, imposer leur direction. Mais une fois le cap fixé, Madame Merkel fait dépendre son accord de trois choses: l’issue des prochaines élections pour un parlement régional, le traditionnel arrêt de la Cour Constitutionnelle de Karlsruhe et l’aval du Bundestag. Ce qui permet aux marchés de se refaire une santé et de souffler encore plus fort. Entretemps, la tempête fait des ravages sur le continent et balaie sur son passage les marges politiques, les capacités d’endettement, les acquis sociaux et… les gouvernements grec et italien.
Quant au membre italien de l’équipage, Silvio Berlusconi, il a été invité à quitter le navire. Non seulement, il n’avait pas le pied marin, mais encore lui arrivait-il de confondre le navire « Eurozone » avec un bateau de plaisance. Toutefois, le Ciao de soulagement poussé à l’occasion de son départ ne signifie pas pour autant la fin de nos soucis.
October 20th, 2011 by Charles Goerens
Une victoire pour la démocratie
Les «primaires» font partie, depuis toujours, du «paysage» politique des Etats-Unis. Est-ce que l’exemple des primaires socialistes français fera école ailleurs en Europe? Sera-t-il suivi demain en Allemagne par les sociaux-démocrates lorsqu’il s’agira de départager les candidats et désigner un challenger pour Angela Merkel? Pourquoi pas? Finalement, les primaires du Parti socialiste français ne se sont pas trop mal passées. Il s’agit même d’un franc succès.
Et pourtant, il ne s’est pas agi, en l’occurrence, d’une opération sans risques tant était incertaine la participation citoyenne à une opération sur un terrain jusque-là inexploré. A cela s’ajoutait une autre difficulté, celle qui consistait à savoir si les municipalités acceptaient d’y apporter leur concours logistique. Ce dernier aspect qui n’était pas acquis d’avance – les maires invités à autoriser les élections dans les lieux publics n’étant pas tous de gauche – ne s’est révélé que très marginalement perturbateur. En ce qui concerne la participation, les responsables du PS espéraient pouvoir mobiliser au moins un million de citoyens, nombre bien supérieur aux seuls militants socialistes qui représentent à peine un tiers du niveau de participants visé. Avec 2,7 millions d’inscrits au deuxième tour, on peut parler d’une mobilisation allant bien au delà des attentes.
Le PS, qui ambitionne de reprendre la Présidence de la République, après dix-sept années d’opposition, vient de remporter une belle manche dans la course vers l’Elysée.
Il ne s’agit toutefois que d’une étape, au terme de laquelle il faut reconnaître que la personnalisation de la politique française fait son petit bonhomme de chemin, tendance clairement confirmée par les primaires.
Retenons donc, à propos des primaires, une belle opération de communication doublée d’une mobilisation sans précédent.
Quant au fond, le discours de François Hollande, qui l’a finalement emporté sur tous ses concurrents, s’adresse à une France malade de ses déficits budgétaire et commercial, creusant l’écart avec l’Allemagne, à ses dépens d’ailleurs. Suffisamment réaliste, le candidat socialiste aux présidentielles, qui veut être un président «normal», parti en campagne bien avant ses concurrents, a pu prendre la mesure de l’impact de la crise sans d’ailleurs se faire trop d’illusions sur les actions à engager, une fois investi de la plus haute fonction.
Dans la bataille qui ne fait que commencer, François Hollande, auquel d’aucuns ont reproché d’avoir été trop vague sur ce qui attend les Français après les présidentielles de 2012, a su résister cependant à la tentation du «il n’y a qu’à, il faut que…».
Ayant renoncé aux effets de tribune faciles, il va ainsi donner du fil à retordre à l’actuelle majorité présidentielle. Le fait d’avoir su refuser un discours complaisant le distingue par rapport à ceux qui, naguère encore, incarnaient cette gauche détentrice du monopole du rêve.
Ceux qui, à droite, croient pouvoir entamer sa réputation en le présentant comme un marchand d’illusions vont s’apercevoir assez rapidement que François Hollande, sous son air bonasse, pourrait se révéler être un redoutable tacticien. Qu’on se le dise: Le corrézien n’a pas encore dit son dernier mot. Les autres partis, par contre, et notamment l’UMP, n’auraient-ils pas intérêt à sélectionner, à leur tour, leur candidat dans le cadre d’élections primaires? Un obstacle de taille, cependant, s’y oppose: l’égo surdimensionné du président en exercice. Bien que ne faisant pas l’unanimité au sein de son propre camp, Nicolas Sarkozy s’interdit encore toute ingérence dans son plan de campagne.
De nos jours, les citoyens ne sont plus enclins à suivre aveuglément un leader. De ce point de vue, les primaires ont l’avantage de mettre fin à l’asservissement inconditionnel des troupes à une seule personne.
Qui va perdre les prochaines élections présidentielles? On ne le sait pas encore. Toujours est-il que l’on connaît déjà un premier vainqueur: la démocratie.
June 16th, 2011 by Charles Goerens
Qui est Apollon?
Malgré tous les efforts entrepris depuis le début de la crise, la Grèce a vu sa dette publique totale atteindre cette année le seuil de 150 % de son revenu national brut (RNB). On savait d’emblée qu’une seule année n’allait pas suffire pour corriger les dérapages, dont le pays en difficulté est, sans aucun doute, le premier responsable. Avec ses 10% de déficit nouveau pour la seule année 2010 on est, cependant, encore loin des 3% d’endettement net annuel fixé comme objectif à moyen terme.
La chute du RNB grec au cours de la même année est à la fois une cause et une conséquence de l’aggravation de la crise de la dette. En effet, le recul frôlant les 4% de la richesse produite par le pays en question a pour effet de masquer en partie les efforts consentis par le Gouvernement Papandreou. Si, par contre, le RNB avait augmenté de 2%, comme c’était le cas dans la plupart des Etats membres de l’Union économique et monétaire de l’UE (UEM), le ratio dette publique/RNB serait moins inquiétant. Il s’agit là d’un effet mécanique aux conséquences dramatiques, car même si la dette en 2010 était restée inchangée en valeur absolue, elle aurait quand-même augmenté en valeur relative par rapport au RNB d’une année à l’autre. Et pourtant, tant que l’économie hellène tarde à décoller, il y a peu d’espoir de voir la situation de sa dette publique évoluer dans un sens favorable.
Les temps présents constituent pour l’UEM un vrai dilemme. Ménager à la Grèce une plus grande marge de manœuvre budgétaire, lui permettant de favoriser la relance économique, signalerait aux marchés un relâchement dans les efforts de redressement du pays. Répondre à la situation actuelle par une dose accrue d’austérité risque, en revanche, de paralyser un pays menacé d’explosion sociale.
Comme si ce constat n’était déjà pas suffisamment sombre, des responsables politiques nationaux au sein de l’UEM ne ratent aucune occasion pour ajouter à la confusion. Avec tous les « il n’y a qu’à » ou les « il faut que », sans oublier les propos populistes de certains, l’insécurité a trouvé le terroir idéal pour prospérer. Quand, finalement, une prise de position des autorités européennes voit le jour, celle-ci est souvent truffée d’arrière-pensées au point d’être illisible pour le commun des mortels. Nombre de prises de position font penser à certains communiqués de l’OTAN que ne comprennent souvent d’ailleurs que ceux qui les ont négociés. L’on serait même tenté de comparer la situation actuelle au désarroi auquel ont pu donner lieu les prophéties de la Pythie dans la Grèce antique. Mais comparaison n’est pas raison. Certes, dans l’Union européenne on n’est pas en mal de prophètes, mais qui incarnerait le rôle d’Apollon? José Manuel Barroso, Olli Rehn, Commissaire aux affaires monétaires, Jean-Claude Juncker, Président de l’Eurogroupe ou Herman van Rompuy, Président du Conseil européen?
Nous voilà renvoyés au problème du leadership européen. Là où on s’attend à des annonces convergentes, on reste sur sa faim: désormais, des orientations utiles qui intègrent à la fois les sacrifices pouvant être honnêtement exigés du peuple grec, mais aussi la contribution des autres Etats membres de l’Eurozone sont requises d’urgence.
Seuls les marchés sont actuellement les maîtres du jeu. La ligne des marchés reste pour l’instant le mobile influant le plus sur le cours des choses, cela au sens propre comme au sens figuré. Les marchés exploitent toutes les opportunités: les fondamentaux de l’économie grecque, tout comme les faiblesses du système politique tant national qu’européen. Ils agissent pour ainsi dire sans contrepouvoir réellement perceptible, capable de définir les pistes d’une sortie de crise intégrant aussi bien la réalité politique que sociale.
Les marchés ont bien entendu un rôle important, voire indispensable à jouer. De là, à leur accorder une confiance aveugle reviendrait à oublier qu’ils sont opportunistes et savent s’adapter aux situations politiques les plus diverses. Aurait-on déjà oublié que les marchés, lorsque ça les arrange, peuvent réagir favorablement au système économique mis en place par les dictateurs. Ils ont, notamment, réservé un accueil favorable aux politiques économiques de Pinochet, voire d’Hitler. Les défenseurs de la démocratie et des valeurs qui y sont rattachées devraient bien se le rappeler.
May 24th, 2011 by Charles Goerens
L’Europe prise en otage
L’issue de ce que Jacques Delors qualifiait volontiers de la «dernière grande aventure collective» en parlant de l’intégration européenne paraît aujourd’hui plus que jamais incertaine. En clair, le moteur de l’intégration européenne est sensiblement endommagé. Il est assez curieux de constater que cette évolution, apparemment, ne choque plus personne. La lecture de la presse internationale, ces derniers temps, montre à quel point le doute s’est déjà installé. La cacophonie autour de la crise budgétaire grecque fait le gras non seulement des journaux anglo-saxons – on s’y était habitué – mais aussi, et ce de plus en plus, de l’ensemble des publications.
Ce qui est nouveau dans l’euroscepticisme de nos jours, c’est son ampleur d’abord. Plus personne pour ainsi dire n’ose encore prendre la défense d’une Union européenne que d’aucuns considèrent être devenue entre-temps une partie du problème. Ainsi l´arrivée de quarante mille réfugiés d’origine nord-africaine sert-elle de prétexte à plusieurs États membres de l’Union européenne souhaitant remettre sur le métier les accords de Schengen. C’est l’Italie qui a ouvert la boîte de Pandore en voulant se débarrasser au plus vite des migrants venus pour la plupart de Tunisie. La réaction de la France ne s’est pas fait attendre et les deux pays se sont finalement prononcés en faveur d’une modification des accords de Schengen sur certains points.
Si le nombre d’immigrés principalement d’origine tunisienne en Italie peut paraître élevé, il importe toutefois de le mettre en relation avec l’arrivée de demandeurs d’asile d’origine balkanique dans notre pays en 1999. L’accueil, pendant la guerre du Kosovo, de près de quatre mille citoyens des Balkans occidentaux par le Luxembourg – dont la population est voisine d’un demi-million de personnes – n’était certes pas une mince affaire. Notre gouvernement, à l’époque, n’envisageait pas pour autant une entrave à la libre circulation des personnes, qui reste d’ailleurs l’un des acquis les plus tangibles de la coopération européenne.
Toutes proportions gardées et dans un effort comparable, l’Italie, dont la population est 120 fois supérieure à la nôtre, devrait donc être en mesure d’accueillir aujourd’hui 480.000 immigrants. Rien que de ce point de vue, la réaction italienne est, à ce stade, franchement démesurée.
Là où des propos plus modérés seraient de mise, les responsables politiques italiens soufflent sur la braise. Certes, tout État membre est en droit d’en appeler à la solidarité de ses partenaires. Il n’est d’ailleurs pas question de laisser l’Italie seule face à un afflux vraiment massif de ressortissants nord-africains. Avec son agitation excessive et prématurée cependant, l’Italie s’attaque aux fondements même de l’acquis de Schengen. Mais à y regarder de plus près, l’on se demande tout de même si au-delà du problème de l’immigration – illégale ou non – la posture actuelle de Silvio Berlusconi ne s’expliquerait pas par les difficultés qu’il rencontre sur le plan politique intérieur de la péninsule. Dans l’exploitation abusive des craintes, pour la plupart injustifiées d’ailleurs, le président du Conseil italien n’hésite pas à faire un clin d’œil à ceux qui sont tentés par des positions plus dures en matière de contrôle de l’immigration. Cela paraît d’autant plus plausible que le gouvernement du Danemark, soucieux à son tour de calmer les vagues de contestation d’une droite populiste, enfreint carrément le fonctionnement de Schengen par le rétablissement du contrôle des personnes à ses frontières avec l’Allemagne et la Suède.
La digue serait-elle déjà sur le point de céder? Le test de résistance va nous le révéler. Le moins qu’on puisse dire, c’est que nous ne sommes pas en présence d’une situation banale. Sans vouloir verser dans la panique, il y a lieu tout de même d’inviter tous ceux qui ne veulent pas s’accommoder de l’idée d’une Europe offerte, à se mobiliser en faveur d’une Europe ouverte. En attendant que tous les citoyens européens soucieux de préserver les acquis de la construction européenne le manifestent plus clairement, leurs dirigeants seraient bien inspirés de renoncer dorénavant à jeter de l’huile sur le feu.
April 20th, 2011 by Charles Goerens
Le refus de la fatalité: L’exemple du SIDA
Pour gagner un pari sur l’avenir, il faut de l’audace, de la clairvoyance et de la détermination. L’histoire du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme en est une belle illustration. Remontons à la seconde moitié des années 1990, au moment où apparaissent les premiers médicaments antirétroviraux (ARV) dans les traitements des patients atteints du SIDA. C’est le début d’un immense espoir pour tous les malades jusque-là voués à la disparition quasi certaine. Désormais, l’agonie ne constitue plus l’issue tant redoutée par tous ceux que le dépistage a révélés séropositifs.
La bonne nouvelle, hélas, n’atteint que les malades qui vivent dans les pays riches. Ceux qui ont le malheur d’être séropositifs au Mali, au Soudan, au Zaïre ou au Rwanda restent privés d’accès à la trithérapie, à moins de faire partie de la classe privilégiée. L’Afrique, qui demeure la plus touchée par le fléau du SIDA, voit ainsi le fossé se creuser davantage encore, non seulement entre riches et pauvres, entre ceux qui ont accès au savoir et ceux qui en restent écartés, mais également entre patients qui ont droit aux soins et ceux qui sont condamnés à mourir dans l’indifférence générale. Tout porte à croire, vers la fin du siècle dernier, que cette situation va encore s’empirer.
Le débat politique tourne alors autour de l’incapacité d’inverser cette tendance. Parmi les explications le plus fréquemment utilisées par les responsables politiques des pays riches figurent en premier lieu le prix exorbitant des médicaments – les ARV coûtent en effet 10000 dollars par patient et par an à cette époque – ainsi que la précarité des systèmes de santé dans les pays en voie de développement. Il n’est, dès lors, pas étonnant de voir même la plupart des ministres de la coopération au développement prétexter du coût très élevé pour couper court à toute tentative d’explorer des voies d’accès aux ARV pour les malades du SIDA en Afrique. Le discours finit par s’articuler autour des vertus de la prévention dont le prix est de toute évidence très inférieur à celui occasionné par l’accès aux soins. Vouloir privilégier la prévention se heurte cependant à un obstacle de taille : où est l’intérêt d’un Africain d’accepter un dépistage si, en revanche, il n’y a pas le moindre espoir de thérapie? L’informer de sa séropositivité revient dès lors à lui annoncer sa mort, ne cessera de marteler Bernard Kouchner.
Au tournant du millénaire, la résistance commence à s’organiser. Les appels politiques se multiplient, des mouvements associatifs en Afrique du Sud notamment, visant à mettre fin à l’«apartheid» dont sont victimes les malades dans les pays en développement, ont le «culot» de défier l’industrie pharmaceutique. L’idée, selon laquelle l’accès aux médicaments essentiels ne peut plus se réduire à une question de brevet, est à l’origine d’une avancée assez spectaculaire lors de la conférence de Doha en 2001. L’Organisation mondiale du commerce réussit en effet à se mettre d’accord sur l’idée de l’urgence sanitaire qui va avoir pour effet de tolérer dorénavant la fabrication d’antirétroviraux dans un laboratoire national d’un pays en développement sans entraîner pour autant des sanctions au cas où le brevet serait encore protégé. Dès lors, l’on ne peut plus invoquer de circonstances atténuantes à propos de la non-assistance aux malades du SIDA en danger, si ce n’est l’absence d’un cadre organisationnel approprié.
Avec la création, en l’an 2002, du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, finalement, la lutte pour l’accès aux soins thérapeutiques dans les pays en développement prend un tournant décisif. Neuf ans après sa création, le Fonds peut faire état de sept millions de vies sauvées, dont 3 millions de malades du SIDA. Aussi le montant voisin de 10000 dollars pour un traitement trithérapeutique annuel, avancé par les sceptiques de tous bords dans les années 1990 pour justifier leur refus de propager les soins en Afrique, se situe-t-il à des années lumière de la réalité aujourd’hui. Faut-il rappeler que, de nos jours, le coût du traitement annuel oscille entre 120 et 150 dollars ? C’est dire que la projection sur l’avenir d’une situation momentanée peut paraître non seulement aberrante mais carrément irresponsable. Si l’on n’avait écouté que les Cassandre, on aurait été réduit au rôle de comptable de 7 millions de personnes mortes dans l’insouciance générale. De plus, il n’y aurait pas le moindre espoir pour les dizaines de millions de femmes, d’hommes et d’enfants porteurs du virus VIH en 2011. Cela peut se résumer en un bout de phrase : le prix de la fatalité.
La morale de l’histoire ? La fatalité conduit à la rigidité, la rigidité conduit à l’immobilisme et l’immobilisme à la mort. Une bonne dose d’humanisme, doublée d’une volonté de fer, par contre, peut nous amener à découvrir des horizons nouveaux. Le mouvement de résistance, dont il est question ci-dessus, va permettre à des millions de personnes de survivre. Oui, on peut transformer l’essai. On devra s’en inspirer afin d’imaginer des coopérations au développement intelligentes et couvrant encore d’autres domaines que celui de la santé qui, demain, permettront à ces mêmes personnes non seulement de survivre mais de vivre.
March 17th, 2011 by Charles Goerens
LA CESURE
Le récent tremblement de terre au Japon peut donner lieu à une double lecture. D’un côté, les constructions dans leur ensemble ont plutôt bien résisté aux chocs d’une rare brutalité. Cependant le bilan en termes de pertes en vies humaines est terrible. Néanmoins le fait que le nombre de victimes n’a pas pris des dimensions encore plus gigantesques est dû uniquement à une politique de prévoyance menée de très longue main. Mais peut-on s’imaginer l’ampleur du désastre si des mesures visant à atténuer l’impact d’un éventuel tremblement de terre n’avaient pas été prises depuis des décennies. Des pans entiers de l’économie japonaise et notamment le secteur de la construction avaient intégré depuis longtemps les mesures de limitation des dégâts dans leurs projets d’urbanisation.
Pour ce qui est des centrales nucléaires, peut-on porter encore la même appréciation quant aux mesures arrêtées afin de prévenir le pire ? Au plan de la planification desdites centrales, on nous apprend que tout a été fait pour prévenir les fuites de radioactivité en cas de tremblement de terre d’une puissance 8,2 sur l’échelle de Richter. Or avec 8,9 sur la même échelle, la vigueur des secousses a été supérieure de presque dix fois aux hypothèses extrêmes servant de base de calcul aux concepteurs de l’industrie nucléaire du Japon.
Au moment où la terre n’a pas encore cessé de trembler, la décence nous interdit de nous ériger en donneurs de leçons dès lors que les citoyens japonais qui font preuve d’une dignité exemplaire ne savent pas de quoi demain sera fait. D’ailleurs notre empathie peut-elle être comparée à celle des gens côtoyant les survivants qui redoutent par ailleurs une catastrophe nucléaire de grande ampleur ? Faisons d’abord tout ce qui est en nos moyens pour aider les citoyens japonais à dépasser dans l’immédiat le stade des privations de toute nature à commencer par les difficultés d’approvisionnement sur l’un des territoires les plus peuplés du monde. Plus tard, mais plus tard seulement, après avoir retrouvé tant soit peu une « vie normale », le Japon devra faire son introspection.
Dans nos pays par contre, l’interpellation de notre passé bat déjà son plein. Elle va se cristalliser autour de la question de savoir quelle cause devrait servir le progrès. Le progrès au service de la seule croissance du P.I.B est –il encore défendable? Comment pourra-t-on écarter les risques inconsidérés ? Qu’est-ce qu’un risque calculé ? Faut-il appliquer le principe de précaution à l’américaine ou à l’européenne? Face à l’incertain, le maître mot va-t-il être le « risque zéro » ? Mais avant tout, allons-nous renoncer à toute aventure collective ?
L’Europe vieillissante semble avoir relégué définitivement au passé l’esprit pionnier qui au lendemain de la seconde guerre mondiale a présidé à sa création. L’élan de ses débuts a fini par s’estomper et c’est la frilosité qui l’empêche de rallumer le feu sacré auquel elle doit les plus belles pages de son histoire. Et pourtant les défis ne manquent pas. L’approvisionnement durable en énergie avec la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre qui est à ranger au premier plan des grands défis collectifs en est un. Parions que ceux qui naguère encore n’y voyaient qu’une élucubration de quelques rêveurs vont finir par découvrir le vrai potentiel des « renewables ». Et puis si risque il devait y avoir en matière de production d’énergie renouvelable, il serait sans commune mesure avec celui généré par les centrales nucléaires. Voilà donc un domaine dans lequel on peut oser.
Or pour réussir un grand projet, il faut avoir une vision, de l’ambition, une feuille de route et bien-entendu des moyens à la hauteur de ses attentes. Mais est-ce suffisant ? Pas tout à fait car une bonne capacité de résistance à l’incompréhension, pire encore à l’indifférence sans oublier la raillerie à laquelle on s’expose en cas d’échec peut s’avérer indispensable.
« Notre nation doit s’engager à faire atterrir l’homme sur la Lune et à le ramener sur Terre sain et sauf avant la fin de la décennie.» C’est avec ces mots que, le 25 mai 1961, Kennedy donne le coup d’envoi d’un des projets les plus ambitieux de l’humanité. Huit ans plus tard, le rêve devient réalité. Comme il s’agit en l’occurrence de l’une des dernières grandes réussites collectives de l’Histoire contemporaine, qu’attendons-nous pour nous en inspirer dans notre démarche actuelle?
February 8th, 2011 by Charles Goerens
Côte d’Ivoire, Egypte, Tunisie…
Commençons par une banalité. Comme la démocratie est bien le régime dans lequel le peuple détient le pouvoir, il revient au peuple de décider ce qui a lieu d’être à l’intérieur de ses frontières et à personne d’autre. Mais que faire en cas de privation de ces droits ?
En cas de menace de ses acquis démocratiques, respectivement de sa souveraineté, un peuple peut se faire aider de l’extérieur. Nous avons connu cette situation en 1944. Occupé par les nazis, le Luxembourg ne retrouve sa liberté que grâce à l’intervention des alliés. Il ne viendrait à l’esprit de personne de douter, un seul instant, de la légitimité de l’intervention alliée et ce pour deux raisons. D’abord elle répond aux attentes du peuple et de surcroît, entre 1940 et 1944, notre pouvoir exécutif légal en exil fait tout pour qu’elle se matérialise. Lorsque le pouvoir du peuple est bafoué par une puissance étrangère, une ou plusieurs autres puissances peuvent intervenir sans enfreindre pour autant le droit international.
Les choses deviennent plus compliquées lorsque le pouvoir d’un peuple est confisqué par ses propres dirigeants. Le droit international distingue donc entre peuples opprimés par une puissance extérieure et peuples opprimés par leurs propres dirigeants. Le recours éventuel à des forces armées étrangères pour installer Ouattara à la présidence de la Côte d’Ivoire n’est pas compatible avec le droit international. De ce point de vue, la menace émanant de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CDEAO), qui consiste à vouloir écarter Laurent Gbagbo du pouvoir, qu’il occupe sans plus aucune légitimité, aurait peu de chances de se voir réaliser.
Même situation en Tunisie, à la différence près, que la révolte du peuple n’a pas été précédée par l’élection libre d’un nouveau dirigeant. Le ras-le-bol du peuple tunisien n’ayant jusque-là pas pu s’exprimer correctement dans les urnes, s’est finalement déplacé dans la rue, où il a obtenu gain de cause, du moins en partie… Le peuple tunisien doit cette victoire à son seul courage. Il n’y a de lauriers à prendre par personne en dehors de la Tunisie, y compromis par l’auteur de ces lignes qui, comme tant d’autres, avait sous-estimé le degré d’exaspération du peuple tunisien.
C’est avec le même sentiment d’humilité qu’il va falloir aborder les émeutes survenues en Egypte. Notre posture de résistants de la dernière heure n’a rien de glorieux. Là aussi, sans le courage, voire le culot manifesté par les Egyptiens au cours de la dernière semaine, il y a fort à parier que le caractère étouffant du régime n’aurait pas dominé le journal de 20 heures. Mais depuis que nous avons pris connaissance des images des blessés, victimes de la répression d’un régime dont les jours sont comptés, nous avons une folle envie de venir au secours de ces pauvres gens qui ne demandent qu’à pouvoir jouir des mêmes droits que les citoyens de l’autre rive de la Méditerranée.
Les révoltes ivoiriennes, tunisiennes et égyptiennes, nous rappellent une fois de plus que, quelles que soient les difficultés, les coups décisifs portés aux pouvoirs répressifs, viennent rarement de l’extérieur. Est-ce à dire que la responsabilité de nos pays serait nulle dans la longue oppression des peuples qui aspirent au changement ? En tout cas, la remise en question du passé du monde arabe par ses citoyens vient de commencer de façon spectaculaire. Cet examen critique ne pourra pas non plus épargner les relations de ces pays avec le reste du monde et notamment avec l’Europe. L’Union européenne, quant à elle, ferait bien de ne pas trop tarder à pratiquer son introspection à ce propos.
Une analyse critique de nos relations avec les Etats arabes doit-elle prendre cependant la forme d’un exercice d’auto-flagellation ? Pas nécessairement. Le sort des Egyptiens en 2011 serait-il meilleur si nous avions renoncé à développer des relations économiques avec leur pays ? Fallait-il ostraciser Moubarak, l’un des rares dirigeants arabes ayant reconnu le droit à l’existence d’Israël ? Non, Moubarak n’est pas Hitler. Pour autant cela ne fait pas de lui un démocrate. Les manifestants égyptiens, faut-il le rappeler, ne se sont révoltés, ni contre le développement économique de leur pays ni contre la politique extérieure de leur gouvernement. Par contre, c’est bien contre l’incapacité du régime de transformer les potentialités économiques réelles en progrès social que se déchaîne la colère collective. Les Egyptiens manifestent contre Moubarak, symbole de la corruption qui ronge tout espoir d’amélioration de leur situation personnelle, mais pas contre l’autre Moubarak, soucieux de marginaliser les « Frères musulmans ». Les Egyptiens demandent le départ de celui qui, au nom de la lutte contre l’islamisme, a fini par brider un peuple tout entier.
Dans leur réaction aux événements qui ont lieu à l’heure actuelle dans le monde arabe, l’Occident a été pris de court. Où ne serait-il pas indiqué de parler plutôt de valse-hésitation à propos de l’attitude adoptée par les responsables européens ?
Que pouvons- nous faire en ces heures critiques ? Les Egyptiens sont bien trop fiers pour se laisser voler leur révolution. Toute ingérence serait contreproductive, rappelle-t-on comme un rengaine. L’Europe serait-elle dès lors cantonnée au rôle d’observateur privilégié de l’Histoire ? N’est-ce pas à l’Union européenne de contribuer à faire bouger les lignes dans un monde arabe qui aspire en majorité à des valeurs qui ne sont finalement pas si différentes des nôtres ?
Depuis le début des émeutes, les signaux émanant de la diplomatie européenne n’ont pas été très convaincants. Ceux qui se battent dans les rues du Caire ou d’Alexandrie attendent sans doute autre chose qu’un simple rappel des impératifs de la realpolitik. La voix de Lady Ashton est à peine perceptible dans le concert des réactions. C’est bien dommage car en cas de victoire des opposants, un gigantesque effort de redressement attend les Egyptiens. Cet effort dépassera les moyens dont ils disposent. En pareille circonstance, les Européens sont toujours les premiers et les plus efficaces à contribuer aux projets de leurs partenaires. Le Pakistan, Haïti, Les Territoires palestiniens, les Balkans occidentaux, entre autres, peuvent en témoigner. Si au moins, on pouvait faire passer ce message à une Egypte, qui n’est certes pas offerte mais qui reste ouverte, on ne ferait peut-être pas si piètre figure dans les yeux de ceux qui ont le visage couvert de sang.
December 9th, 2010 by Charles Goerens
LA REFORME DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
(DEUXIEME PARTIE)
Si l’on veut exclure le pire, c’est-à-dire l’absence d’accord sur la future PAC, une démarche commune franco-allemande est certes indispensable, même si elle peut paraître insuffisante. Il va donc falloir trouver des Etats « like minded ». De ce point de vue, d’autres pays à fort potentiel agricole auraient leur mot à dire. La Pologne, par exemple, déjà trop importante pour être ignorée mais pas encore suffisamment forte pour pouvoir s’imposer seule, pourrait prendre la direction d’un groupe de pays qui insistent que soit mis fin au traitement qu’ils considèrent être discriminatoire en matière d’aide directe aux exploitations agricoles. Les agriculteurs des nouveaux Etats membres de l’Union européenne touchent effectivement des montants sensiblement inférieurs à ceux alloués à leurs homologues français, allemands ou britanniques.
Ce qui est certain, par contre, c’est qu’un accord devient impensable sans faire entrer Londres dans la combine. Pour ce faire, le Royaume-Uni, ultra pragmatique, est bien-entendu conscient du fait que l’UE – qui lui garantit son fameux rabais budgétaire – n’aura pas la moindre chance de reconduire sans l’accord de la RFA et de la France. En effet, le cadre financier encore en vigueur prendra fin en 2013 tout comme la PAC actuelle. Tout et rien n’étant pas des options, le Royaume-Uni sait qu’il lui sera impossible d’obtenir le beurre et l’argent du beurre. En bons stratèges, les responsables gouvernementaux d’Outre-Manche, en quête d’alliés finiront sans doute par s’inspirer de Winston Churchill, qui avec son sens légendaire de la formule, nous a appris que : s’il y a une chose encore pire que celle qui consiste à lutter avec des alliés, c’est de lutter sans alliés.
A l’heure ou ces lignes sont écrites, toute déclaration sur la future PAC pourrait se révéler hasardeuse. Pour difficiles qu’elles soient, les négociations ne pourront aboutir que si tous les Etats membres sont prêts à faire des concessions.
Tout cela ne suffit pas encore à rassurer le monde agricole qui peine encore à sortir de la crise de 2009 marquée par la chute spectaculaire des prix agricoles. Sans être en mesure de deviner d’ores et déjà les contours précis de la future PAC, on peut tout de même mentionner, à ce stade, quelques éléments qui finiront sans doute par jalonner l’itinéraire que devra emprunter l’agriculture européenne après 2013.
1) Personne n’aura intérêt à manœuvrer l’Union européenne dans une impasse. Un blocage de l’Union européenne dans un secteur donné, en l’occurrence l’agriculture, devrait entraîner inévitablement un effet boumerang pour tous les Etats membres et en premier lieu pour l’auteur de l’échec des négociations.
2) En principe, la régulation des marchés n’est pas interdite par le Traité de Lisbonne en vigueur depuis décembre 2009. Il y a dès lors lieu de tabler sur la possibilité de recourir – également après 2013 – à des mécanismes d’intervention susceptibles de protéger les agriculteurs contre les conséquences les plus fâcheuses de la volatilité des prix. Rappelons cependant que si l’intervention dans le fonctionnement du marché était devenue la règle jusqu’au début des années 1980, celle-ci va sans doute devenir l’exception après 2013, ce qui ne ferait qu’accentuer une tendance de fond confirmée par les réformes successives de la PAC.
3) Il en est de même des restitutions à l’exportation de produits agricoles dans les pays tiers, option à laquelle l’Union européenne a déjà renoncé en principe dans le cadre du Doha Round. Si en l’an 2000, le recours à cette possibilité a encore coûté 10 milliards d’euros au budget de l’Union européenne, ce montant n’était plus que de 350 millions huit ans plus tard. La situation – de ce point de vue – a donc fondamentalement changé, mais le discours présentant l’Union européenne comme le fossoyeur de l’agriculture des pays en développement est resté le même. Il importe dès lors d’objectiver le débat, déjà suffisamment compliqué sans être hypothéqué par des aspects irrationnels de ce genre.
4) La volonté de différencier davantage les aides agricoles en fonction de critères régionaux tenant compte des handicaps naturels est devenue une perspective réelle. Ceci doit intéresser plus particulièrement l’agriculture luxembourgeoise déjà bénéficiaire de cette mesure à l’heure actuelle.
5) Outre les aspects inhérents à toute négociation politique et plus particulièrement ceux ayant trait aux contraintes budgétaires récurrentes, l’ère agricole post-2013 sera caractérisée – on peut déjà le constater à l’heure actuelle – par une plus grande exposition au risque de l’agriculteur. Des filets de sécurité moins performants que par le passé feront coexister deux types d’agriculture pour ce qui est du revenu agricole: Le paysan européen devra décider s’il voudra être plus dépendant des cours des matières premières agricoles ou s’il entend opter pour une relation plus personnelle avec le consommateur. Autrement dit, il sera amené à choisir s’il voudra dépendre en matière de revenu plutôt de la bourse de Chicago ou du pouvoir d’achat d’une clientèle de proximité.
6) En matière de lutte contre le changement climatique, les experts scientifiques s’attendent à voir l’agriculture jouer un rôle crucial à l’avenir. Les espoirs dans ce domaine concernent moins le secteur agricole comme producteur d’énergie alternative renouvelable, mais plutôt la capacité d’absorption de CO2 par les terres arables. Celle-ci constitue, en effet, un potentiel important, voire indispensable en vue d’atténuer le réchauffement de la planète. Le professeur Stiglitz estime que la dégradation de la matière organique résultant de la déforestation ou d’un changement d’affectation des sols serait responsable à elle seule d’une émission de CO2 équivalente aux quantités de gaz à effet de serre produites par les Etats-Unis.
7) Lorsque la PAC réformée arrivera à son terme en l’an 2020, les réserves mondiales en énergies fossiles seront certes encore fort importantes, mais la nécessité de préparer l’ère post-pétrole sera devenue une évidence. La vocation de l’agriculture à fournir les matières premières susceptibles de remplacer, ne fût-ce que partiellement, le pétrole, se fera de plus en plus ressentir.
8) La discussion sur l’avenir du secteur agricole ne pourra être déconnectée ni des réflexions portant sur la sécurité alimentaire ni de celles qui ont trait au développement durable de la planète. Selon Edgar Pisani, déjà ministre de l’agriculture sous Charles de Gaulle, on aura besoin de toutes les agricultures si l’on veut éradiquer la famine et la malnutrition à l’échelle globale. Le nonagénaire sait très bien que cette conception est incompatible avec la libéralisation progressive des échanges de produits agricoles. On est cependant nombreux à croire que cela ne constitue pas une raison suffisante pour ne pas aborder les grands défis auxquels se voit confronté l’humanité.
Les aspects institutionnels, budgétaires, environnementaux, commerciaux e.a. ne devraient pas masquer l’enjeu stratégique que représente l’agriculture pour l’Union européenne. De loin meilleure que sa réputation, l’agriculture a vocation à devenir un secteur d’avant-garde.
Il est devenu banal de rappeler que le succès professionnel de l’agriculteur sera aussi à l’avenir comme par le passé fonction, dans une très large mesure, de son niveau de connaissances et de ses capacités de gestion. Cela ne signifie en aucun cas que l’Union européenne n’ait pas de responsabilités à assumer en la matière. C’est à elle que revient la mission de redéfinir un cadre favorable au développement du monde rural. C’est tout l’enjeu de la réforme de la PAC.
November 11th, 2010 by Charles Goerens
LA REFORME DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
(PREMIERE PARTIE)
Où va l’agriculture luxembourgeoise ? La réponse à cette question est directement liée à l’orientation future de la politique agricole commune (PAC). Ce qui ne nous fait guère avancer étant donné que la P.A.C. est elle-même sujette à révision. L e nouveau commissaire à l’agriculture, le roumain Dacian Ciolos a donné le coup d’envoi au mouvement de réforme en sollicitant l’opinion des citoyens sur l’avenir de la PAC. Les questions auxquelles le grand public était invité à répondre portaient sur l’opportunité de maintenir une politique agricole commune, sur les objectifs que la société assigne à l’agriculture européenne, sur la nécessité de réformer ladite politique ou encore sur les outils de la future PAC. Pour originale qu’elle soit, l’approche de la Commission fait penser à une boutade attribuée à un ancien directeur de l’Administration des Ponts et Chaussées déclarant : « Le Luxembourg compte 300 000 habitants. 299 000 savent comment il faut construire les routes et les 1000 autres travaillent dans l’Administration des Ponts et Chaussées ». Avec la consultation de l’opinion publique sur la réforme de la PAC, c’est un peu pareil : lorsque les citoyens, les consommateurs, les industriels, les commerçants, les associations de toute nature se seront prononcés sur l’avenir de l’agriculture européenne il serait utile de connaître aussi la voix des personnes directement concernées, c’est-à-dire les agriculteurs.
Or, force est de constater que le monde agricole n’a pas lieu de s’inquiéter outre mesure du résultat de la consultation sur le net. Nombreux, en effet, sont ceux qui souhaitent maintenir des secteurs agricoles diversifiés à travers l’Europe et qui plus est acceptent d’en payer le prix, le soutien de la PAC étant le prix à payer pour la préservation de l’environnement et le maintien de la cohésion territoriale. Les attentes deviennent fortes dès lors qu’il s’agit de préserver la biodiversité, de contribuer à protéger les nappes phréatiques et de maintenir des activités en milieu rural. Bref, de la consultation en ligne se dégage une acceptation assez forte par l’opinion publique d’une politique agricole européenne durable ayant vocation à assumer sa part dans la lutte contre le changement climatique. Que le secteur primaire a pour mission la production d’aliments de qualité est une évidence pour la plupart des participants à la consultation publique.
Par contre, si le payement unique par exploitation peut tabler sur un large soutien, de nombreux intervenants souhaiteraient des aides plus ciblées sur les petites entités. Quant aux marchés agricoles, nombreux sont les intervenants à s’inquiéter de la volatilité des prix. En revanche, ils préconisent des systèmes de régulation de marché allant de l’instauration d’un filet de sécurité pour soutenir les marchés en cas de crise à une préférence communautaire plus forte. Aussi se pronocent-ils en faveur d’une répartition plus équitable de la valeur ajoutée générée par les divers acteurs d’une même filière de production.
Bien entendu, consultation n’est pas décision mais les auteurs de la réforme ne peuvent pas faire comme si la consultation n’avait pas eu lieu. Celle-ci va servir de référence pour la Commission appelée à présenter son projet de réforme vers la fin de l’année en cours. Il en est de même de tous les acteurs entrant en ligne de compte dans le processus législatif enclenché par les propositions de la Commission.
Le Parlement européen d’abord, investi de nouvelles prérogatives budgétaires depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, ne va ménager aucun effort pour pouvoir peser de tout son poids dans les décisions relatives au financement de la PAC notamment. Mais ce qui va être déterminant dans la phase décisionnelle, c’est la façon dont les Etats membres et notamment les plus grands parmi eux vont se positionner par rapport aux propositions de la Commission. La Commission et le Conseil agricole, loin de sous-estimer les pouvoirs élargis du Parlement européen, sont très conscients, cependant, du rôle crucial que vont jouer la France, la République Fédérale Allemande, le Royaume-Uni. Les Etats membres de l’Europe centrale et orientale de leur côté défendent des revendications spécifiques qui ne sont pas prises en compte par les trois grands.
La France est sans doute le pays pour qui l’agriculture, depuis les débuts de la construction européenne, revêt une importance particulière aux plans politique, économique et culturel. Depuis Charles de Gaulle jusqu’à Nicolas Sarkozy tous les Présidents de la République sans exception se sont toujours engagés pour une Europe agricole forte, présente sur les marchés extérieurs. Ce faisant elle n’a jamais perdu de vue d’avoir été le plus grand bénéficiaire dans le cadre de la PAC. Avec des écarts de productivité assez importants d’une région à l’autre, la France est tout sauf un pays agricole homogène. A la fois agressive sur les marchés extérieurs et soucieuse, par ailleurs, de préserver une politique agricole dans les régions à plus faible productivité, la France a acquis l’habitude de défendre un spectre de revendications très large. Déterminée à conserver la diversité agricole dans l’Hexagone, la France devient ainsi le meilleur avocat des adeptes d’une PAC multifonctionnelle. Cette approche est toutefois moins consensuelle dans nombre d’autres Etats membres de l’Union européenne.
Le Royaume-Uni se situe exactement à l’opposé du modèle que revendique son partenaire français. C’est l’Etat membre de l’Union européenne qui est de loin le plus hostile à la PAC. A vrai dire, les Britanniques préfèrent carrément l’envoyer au diable. Trop chère parce que trop régulatrice et trop bureaucratique, telle est leur perception de la PAC. Le Royaume-Uni aimerait mettre fin au plus vite au système d’aides actuel en faveur de l’agriculture pour remplacer celui-ci par une libéralisation complète du marché agricole. Même indépendamment de son opposition à la PAC, le Royaume-Uni s’oppose en principe à toute mesure susceptible d’entraîner des dépenses importantes au niveau de l’Union européenne. Depuis Mrs Thatcher, tous les Premier-Ministres de Sa Majesté n’ont cessé de revendiquer le fameux rabais budgétaire consistant à rembourser aux Britanniques une partie de leur contribution au budget de l’Union européenne qui, en 2010, équivaut à environ 5 milliards d’Euros.
En République Fédérale Allemande, des voix discordantes ont depuis belle lurette mis fin à l’appui unanime de la PAC. Non pas que les agriculteurs ne compteraient plus d’amis au sein de la classe politique allemande. Ils existent bel et bien, mais ils sont devenus, entretemps moins enthousiastes pour appuyer la PAC. En réalité, les raisons qui ont amené les allemands à donner leur accord aux réformes successives de la PAC, relèvent davantage des impératifs de la Realpolitik. En effet, nombreux sont les décideurs allemands à voir dans la PAC un obstacle au démantèlement des barrières tarifaires dans les relations commerciales de l’Europe avec le reste du monde. Aussi la politique allemande s’inscrit-elle dans un pragmatisme largement conditionné par les relations avec son partenaire français. Même si les relations de ces deux pays ne sont pas toujours au beau fixe ces derniers temps, le moteur franco-allemand est encore en état de fonctionnement. Dans un cadre bilatéral, les deux partenaires, après des divergences manifestes, finissent habituellement par retrouver l’esprit du Traité de l’Elysée qui prévoit que des décisions importantes ne sont prises qu’après consultation entre Paris et Berlin.
October 14th, 2010 by Charles Goerens
Le changement climatique: Notre responsabilité
Les pays en développement sont condamnés à subir les conséquences les plus fâcheuses du changement climatique. Cette situation est d’autant plus cocasse que les pays du Sud à faible développement économique n’y sont pour rien.
Défiés tant par l’ampleur que par la fréquence des catastrophes naturelles (inondations, périodes de sécheresse, ouragans…), les pays du Sud doivent intégrer les changements importants résultant du dérèglement climatique dans leur propre stratégie de développement.
Que faire lorsque ces catastrophes surviennent?
Dans les jours qui suivent le déclenchement des catastrophes, les premiers secours s’organisent, d’une façon générale, assez rapidement. Le monde extérieur, sensibilisé par les images alarmantes, se mobilise dès que les premiers appels à l’aide se manifestent. Cette phase marquée par une très forte mobilisation, toutefois, est assez éphémère étant donné qu’au bout de quelques jours, lesdits faits ne figurent plus au journal de 20 heures.
Vient ensuite la phase de réhabilitation. Celle-ci vise à faciliter le retour à une vie sinon normale du moins un peu plus supportable pour les victimes.
La troisième phase, celle de la reconstruction, a pour but d’offrir des solutions plus durables aux populations sinistrées. Les besoins en hommes et en capitaux, requis pour réaliser les phases d’aide humanitaire d’urgence, de réhabilitation et de reconstruction, dépassent en général les moyens dont disposent les pays en développement. Bref, ils ne peuvent pas s’en sortir tout seuls.
Comment faut-il dès lors s’organiser pour permettre aux populations des pays en développement de surmonter les difficultés résultant du changement climatique?
La responsabilité des nations industrialisées est engagée à plus d’un titre. D’abord, leur promesse de consacrer 0,7% de leur Produit intérieur brut à la coopération au développement est loin d’être réalisée. À l’exception de la Norvège, de la Suède, du Danemark, des Pays-Bas, du Luxembourg et de la Belgique, les États industrialisés n’arrivent pas à tenir leur promesse, renouvelée d’ailleurs pour ce qui concerne les États membres d’ l’UE dans le cadre du consensus européen du développement de 2005.
De plus, une plus grande vulnérabilité des pays en développement souligne de surcroît leur incapacité de faire face, sans appui extérieur, aux risques inhérents au changement climatique dans l’avènement duquel ils ne portent pour ainsi dire aucune responsabilité.
À la conférence de Copenhague, les pays de l’Annexe 1 (pays industrialisés), mis au pied du mur par les pays du Sud, ont finalement accepté de réserver un montant, insuffisant certes, à l’atténuation de l’impact du changement climatique sur les pays en développement. Ce montant doit constituer de l’argent additionnel. Si par contre les 7 milliards à verser par l’UE à ce titre étaient prélevés sur les sommes d’ores et déjà allouées à des fins de développement, cela reviendrait tout simplement à déshabiller Pierre pour habiller Paul.
Le succès de la conférence de Cancún est loin d’être acquis. Ne serait-il pas plus judicieux de renoncer à semer la confusion là où nous avons besoin de repères solides dans la recherche d’une solution?
September 9th, 2010 by Charles Goerens
Le respect des traités: une question de cohérence
Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Mais ne confondons pas entrée en vigueur et mise en œuvre. En effet, la mise en œuvre consiste à traduire dans les faits les dispositions en question. La non mise en œuvre, par contre, condamne les articles d’une œuvre législative à demeurer lettre morte.
La mise en œuvre, rappelons-le aussi, prendra du temps. A ce propos, il n’est pas sans intérêt de constater que, depuis le début de la présente législature, certaines dispositions d’un autre traité, en l’occurrence le Traité de Maastricht, attendent toujours d’être traduites dans les faits. La crise budgétaire grecque vient de nous le révéler. L’absence de discipline budgétaire, le gonflement de la dette publique qui, dans la majorité des Etats membres de l’Eurozone, dépasse de loin le plafond autorisé de 60% de leur Produit intérieur brut, nous donne une idée du fossé existant entre l’état réel et les lignes rouges définies par le Traité de Maastricht.
A titre d’exemple, la Grèce risque même d’approcher 150% de dette publique par rapport à son PIB dans un proche avenir.
D’autres, certes moins fautifs, comme l’Allemagne par exemple, sont, eux aussi, encore loin du compte. Et pourtant les obligations sont bien connues depuis bientôt 20 ans. Comme si les dispositions inscrites dans le Traité de Maastricht et corroborées par le Pacte de stabilité et de croissance ne devaient pas suffire, l’Allemagne vient de faire de la maîtrise de la dette publique une obligation constitutionnelle.
Est-ce à dire qu’une disposition d’un Traité ratifié par les Etats membres, donc contraignante, ne devrait être respectée qu’une fois inscrite dans la loi fondamentale des mêmes Etats? Comme si le droit international ne primait pas sur le droit national, on ne cesse d’inventer, ou plutôt de réinventer des règles d’ores et déjà existantes.
Le citoyen européen, quant à lui, aimerait y voir clair. Dans tout système politique, en effet, les citoyens sont en droit de s’interroger sur les règles applicables par ceux qui les gouvernent. La transparence devrait interdire en principe toute remise en question des règles adoptées, à moins qu’elles ne soient changées dans le respect des mêmes dispositions que celles qui ont présidé à leur adoption.
July 8th, 2010 by Charles Goerens
Après le Mondial: l’Afrique qui ose
Avec la victoire de l’Espagne se termine un événement qui, de l’avis de tous, aura été à maints égards une réussite peu commune. Retenons avant tout l’aspect sportif d’une part et de l’autre le côté plutôt organisationnel. Ce dernier aspect est à mettre à l’actif de l’Afrique du Sud, pays d’accueil de la compétition. Peuvent en témoigner, en effet, les millions de supporters passés dans les stades au cours des derniers mois, ainsi que les milliards de téléspectateurs qui, des semaines durant, ont évolué au rythme du Mondial. La moitié de l’humanité a eu droit à son lot de suspens, d’euphories et de déceptions.
Le football a ainsi révélé, une fois de plus, son pouvoir de mobilisation, sa capacité d’entraînement… La partie la plus visible de ce pouvoir, qui s’est manifestée dans les stades, devant les postes de télévision, sans parler des gigantesques rassemblements populaires autour d’écrans géants érigés à cette fin à des endroits stratégiques, a de quoi rendre jaloux nombre d’acteurs politiques et syndicaux dont les appels à la mobilisation n’arrivent que très rarement à attirer du monde.
Un aspect éclipsé par les moments spectaculaires du Mondial, qui pourtant est de taille, est la qualité de l’accord qu’a réservé l’Afrique du Sud à ses visiteurs. Non seulement la patrie de Nelson Mandela et de Desmond Tutu peut se targuer d’avoir réussi, de ce point de vue, un parcours sans faute, ce qui en soi constitue déjà une belle performance, mais le grand mérite de l’Afrique du Sud aura été d’avoir réussi à changer la perception que nous étions nombreux à avoir jusque-là non seulement de la puissance invitante en particulier mais du continent africain en général.
En moins de cinq semaines, la magie du ballon a réussi à imposer une image du continent noir très différente de celle véhiculée par la perception nourrie au fil des décennies par des stéréotypes de toutes sortes.
N’est-ce pas la première fois dans son histoire que l’Afrique présente à des milliards d’êtres humains une vue du continent qui contraste avec celle misérabiliste, marquée par la corruption, minée par les conflits et les guerres tribales, rendue exsangue par la malnutrition, la famine et le VIH/SIDA?
Certes, un mois de compétition sportive de ce niveau ne remplit pas les greniers du Niger, tout comme le bruit assourdissant des Vuvuzelas n’arrive pas à faire taire les cris de détresse des populations civiles, victimes de conflits interethniques.
Rien n’a changé? Tout a changé! L’Afrique du Sud a eu raison des plus sceptiques qui ne cachaient pas leur inquiétude quant à la capacité de ses autorités d’assurer la sécurité des supporters venus des quatre coins du monde. La même Afrique du Sud ne cesse de susciter l’admiration du monde entier qui lui découvre ainsi du jour au lendemain des talents d’organisateur – avouons-le – assez exceptionnels.
Ce qui a changé, ce n’est pas la réalité africaine, mais bien le regard qui est désormais porté sur l’Afrique. Ce n’est plus l’Afrique qui souffre, qui régresse, qui sombre dans la misère et qui a droit à notre compassion. C’est bien l’Afrique qui agit, qui est aux commandes, qui ose et qui mérite notre admiration. Pour l’Afrique, le Mondial a été une épreuve. Elle l’a surmontée, plus personne ne le conteste. Le Mondial a aussi été la preuve selon laquelle nos voisins du Sud se sont montrés dignes de notre confiance.
June 10th, 2010 by Charles Goerens
Rien que le marché?
Le marché s’attaque au plus faible pour l’éliminer. S’il fallait encore une preuve, la spéculation contre la dette grecque n’aurait pas manqué de nous la fournir. L’Etat solidaire, par contre, se range du côté du plus faible afin de le redresser. Les adeptes du “rien que le marché” argumentent que toute alternative à leur approche ne serait que gaspillage de fonds qui pourraient d’ailleurs être investis plus utilement dans des projets plus rémunérateurs.
Par contre, d’aucuns parmi les interventionnistes ne jurent que par l’Etat, l’Etat réparateur, l’Etat assureur, l’Etat providence. Le débat actuel est dominé par une atmosphère de “déjà entendu”. En effet, la crise actuelle de l’Euro nous fait revivre des aspects de cette confrontation stérile qui, dans certains pays, commence à prendre des allures de guerre froide économique.
L’aide, la réparation, le repêchage relèveraient d’une idéologie périmée. Il importerait dès lors de les proscrire au motif qu’elles s’opposeraient au cours naturel des choses. Dans cette logique, la sortie de la Grèce de l’Eurozone, selon eux, ne serait plus qu’une question de temps. L’idée de projet même – et à fortiori de projet politique – leur paraît déjà suspecte, parce que trop artificielle, trop interventionniste.
Nous assistons en fait à un remake de la confrontation qui précéda l’introduction de l’Euro. Que de résistances n’a-t-on pas dû briser, que d’obstacles n’a-t-on pas dû surmonter en vue de l’avènement de l’Euro?
Kohl, Genscher, Mitterrand, Delors pour ne citer que les dirigeants les plus en vue à l’époque, tous visionnaires et pragmatiques à la fois, avaient ouvert une troisième voie. Celle-ci consistait à ne privilégier ni le recours exclusif au marché ni l’engagement total de l’Etat qui, selon André Malraux, serait le début de l’Etat totalitaire. L’originalité de leur projet consista à ne reprendre de chacune de ces approches que ce qu’elles avaient de meilleur.
C’est dans cette foulée qu’a été mis en place plus tard le Pacte de stabilité et de croissance, un mécanisme susceptible, entre autres, d’assurer la stabilité de la monnaie unique. La règle retenue, encore en vigueur aujourd’hui, vise le plafonnement des déficits publics annuels à 3% du Produit Intérieur Brut (PIB) et requiert également des Etats membres de l’Eurozone de ne pas dépasser, pour ce qui est de leur endettement public total, 60% de la valeur du même PIB. S’y ajoutent quelques éléments de flexibilité applicables en temps de crise économique grave. Faut-il rappeler, par ailleurs, que si entretemps les perspectives de l’Eurozone se sont assombries, c’est parce que les termes du Pacte de stabilité et de croissance n’ont pas été respectés par plusieurs Etats, dont notamment la Grèce et ce bien avant le début de la crise bancaire de 2008. La responsabilité politique de la crise actuelle de l’Eurozone n’est dès lors pas imputable aux pères de l’Euro, mais bel et bien à ceux qui ont trahi l’esprit du Traité, respectivement du Pacte et qui ont fini par le dénaturer aux moyens de montages financiers auxquels GOLDMAN SACHS n’a pas hésité à prêter main forte.
Les tergiversations dont ont fait preuve les plus hautes autorités politiques allemandes et notamment la Chancelière dans le cadre de la crise de l’Euro ainsi que le triomphalisme du Président de la République française au lendemain de l’adoption du mécanisme de stabilisation ne sont plus l’ombre de l’enthousiasme européen naguère encore incarné par le couple franco-allemand. L’on se souvient non sans un brin de nostalgie des temps où le couple franco-allemand représentait encore le moteur de l’intégration européenne. Kohl, Genscher, Mitterrand et Delors ont, certes, trouvé des successeurs. Mais, à vrai dire, Merkel, Sarkozy, Westerwelle et Barroso n’ont pas vraiment réussi à les remplacer.
May 13th, 2010 by Charles Goerens
Le beurre et l’argent du beurre
Au lendemain d’une défaite électorale, les perdants du scrutin s’interrogent sur les causes de la déroute. Dans un premier temps, la réaction se réduit à l’énoncé de quelques banalités: on n’a pas été en phase avec l’électeur, la crise n’a rien arrangé, on n’a pas pu imposer le thème de la campagne, bref, on attribue l’échec soit à une mauvaise stratégie de communication soit à des phénomènes externes soit à ces deux facteurs à la fois.
Au lendemain d’une crise, c’est pareil. Et souvent, l’échec électoral s’explique par l’incapacité d’en venir à bout de la crise. S’il y avait encore un doute à ce propos, il suffirait de rappeler l’impact de la communication du gouvernement fédéral allemand dans le cadre de la crise budgétaire grecque sur le résultat des élections du Nord-Rhénanie-Westphalie réalisé par les deux partis de la coalition sortante qui sont d’ailleurs les mêmes que ceux qui gouvernent à Berlin.
Lorsque la crise économique sera derrière nous, nous nous souviendrons de la corrélation entre la faillite de Lehman Brothers et son effet d’emballement sur le secteur bancaire tout entier qui, à son tour, a fini par déboucher sur l’actuelle crise de l’économie réelle.
Sans attendre l’après-crise, on peut d’ores et déjà retenir que c’est grâce à un haut degré de réactivité doublé d’une action extrêmement pertinente qu’il aura été possible d’empêcher l’économie mondiale qui, le 15 septembre 2008, était au bord du gouffre de faire le lendemain le fameux pas en avant.
Tous les observateurs sont unanimes à reconnaître à l’ensemble des responsables de la politique monétaire et budgétaire d’avoir fait preuve de sang-froid et de clairvoyance et d’avoir par là-même réussi à redonner confiance à tous les acteurs impliqués, et notamment à l’opinion publique.
Au lendemain de la crise de l’euro, il n’est pas sûr de voir les commentateurs exprimer le même satisfecit sur la façon dont l’Europe et plus particulièrement le gouvernement allemand a agi au cours des mois de mars et avril 2010.
Rien de rassurant, trop de tergiversations, un peu d’arrogance, voire de populisme vis-à-vis de la Grèce, une perte de crédit auprès des marchés et avant tout de l’opinion publique, ainsi pourrait se résumer la perception des déclarations du gouvernement fédéral dans le cadre de la gestion de la crise grecque.
Avec le recul, on pourra mesurer les dégâts causés par les responsables de Berlin qui voulaient ménager la chèvre et le chou.
La coïncidence de la publication des résultats électoraux du Nord-Rhénanie-Westphalie et de la tenue de la réunion des ministres des finances de l’Union européenne dans la nuit de dimanche à lundi nous rappelle la pertinence de cet adage. Les partis au pouvoir à Berlin doivent le constater à leurs frais. Ainsi se confirme une vérité vieille comme le monde mais applicable à la situation actuelle qui consiste à reconnaître que l’on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. Depuis le petit matin de lundi dernier, c’est officiel: le beurre, c’est pour les socialistes, les verts et la gauche (Die Linke) et l’argent du beurre, il va encore falloir le trouver ou plutôt l’emprunter. Espérons que les taux d’intérêt que nous allons devoir payer dans ce cas de figure seront nettement inférieurs à ceux facturés à la Grèce.
April 8th, 2010 by Charles Goerens
Pour un traitement responsable des données du citoyen
En rejetant l’accord SWIFT, le Parlement européen n’a pas tardé à manifester son opposition à toute intrusion excessive dans la vie privée du citoyen.
Bien entendu, les raisons qui plaident en faveur de la collecte de données à caractère personnel paraissent plausibles au regard des actes terroristes qu’elle est supposée prévenir. Rappelons aussi que l’accord ainsi conclu entre l’Union européenne et les Etats-Unis visait à mieux appréhender les agissements des milieux terroristes en se donnant la possibilité de retracer à un stade précoce les opérations bancaires susceptibles de financer des actes terroristes.
Il n’est donc pas question de prêter ici la moindre intention malveillante aux autorités dépositaires des données à caractère personnel. Si tel était le cas, cela reviendrait à discréditer leur mission qui consiste d’abord à protéger les citoyens et à assurer leur sécurité.
Mais faut-il pour autant donner un droit de regard aux autorités (américaines) sur toute opération bancaire du citoyen européen au motif que celui qui n’a rien à cacher n’aura rien à craindre?
Les doutes émis par les défenseurs des libertés publiques à propos d’un éventuel détournement de données à caractère personnel à des fins douteuses seraient-ils dès lors devenus sans objet? Rien n’est moins sûr. L’histoire du vingtième siècle ne nous invite-t-elle pas à faire preuve d’un peu plus de perspicacité en la matière?
Ainsi, les plus grandes dérives du siècle écoulé ont-elles été des crimes d’Etat dont la dimension a été dans une très large mesure fonction de l’exploitation de données à caractère personnel, comme notamment l’appartenance à un groupe religieux ou à une minorité ethnique. Le fichage des populations juives en Europe ou le recensement des Tutsis selon des critères ethniques définis par les anciens colonisateurs du Rwanda ont contribué de façon décisive à l’ampleur tant de la Shoah qu’au génocide des Tutsis.
N’a-t-on pas sous-estimé le risque systémique inhérent au captage de données à caractère personnel à première vue anodines? Les enseignements du siècle passé sont suffisamment alarmants pour justifier toute mesure de précaution dans le domaine du traitement desdites données.
La prudence s’impose d’autant plus que les responsables du traitement des données ne sont même pas en mesure d’affirmer que les informations dont ils disposent servent vraiment à des fins de lutte contre le terrorisme.
En toute logique, les données recueillies au titre de la prévention d’attaques terroristes dans le transport aérien devraient être accessibles aux autorités de contrôle des passagers dans l’Etat où l’embarquement a lieu.
La tentative d’attentat à la bombe sur le vol 253 du Northwest Airlines à l’approche de Détroit le 25 décembre 2009 aurait pu être déjouée sans trop de difficulté si les données dont disposaient les autorités américaines avaient également été connues des autorités néerlandaises. Or tel n’a pas été le cas, puisque le présumé terroriste a pu embarquer sans le moindre problème à Amsterdam.
Plusieurs tentatives de tirer cette affaire au clair, dont une question parlementaire adressée à la Commission n’ont pas été couronnées de succès. Bien au contraire, la Commission n’a pas été en mesure d’affirmer que les services de renseignement des 27 Etats membres disposaient des mêmes informations que leurs homologues américains. De sa capacité de répondre clairement à cette question dépendra, entre autres, la volonté de nombre de parlementaires à cautionner le dispositif de lutte antiterroriste en vigueur.
March 11th, 2010 by Charles Goerens
Une autre victime de la crise : la courtoisie.
Sans trop se soucier de la météo, encore assez hivernale en ce début de mars, le calendrier fixe de façon arbitraire au 21 de ce mois le début du printemps. Cette année, les signes précurseurs du réveil de la nature se font encore attendre tant sont généreuses les neiges tardives auxquelles on n’était plus habitué. Il en est de même des fortes gelées nocturnes qui, elles aussi, pour ce qui est de leur fréquence et de l’ampleur, sont assez inhabituelles pour la saison.
Ce constat, cependant, ne vaut pas pour l’Union européenne qui, elle, semble bel et bien avoir inauguré le printemps, du moins à en juger de l’intensité des échanges de noms d’oiseaux entre acteurs politiques européens. Un député britannique a mis fin à
l’hibernation diplomatique de l’Union européenne par sa réplique à l’intervention, très
digne d’ailleurs, de M Van Rompuy qui était venu rapporter de sa première réunion informelle en sa qualité de nouveau Président permanent du Conseil européen. En effet, M Farage a défrayé la chronique dans un discours diffamatoire à l’endroit de M Van Rompuy lors de la séance publique du Parlement européen du mercredi 24 février 2010 à Bruxelles.
Sur un ton agressif peu commun qui culmine dans l’impair « You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk », M Farage a endommagé sa propre réputation plutôt que celle de M Van Rompuy pourtant visé par ses invectives.
Le politically correct, il est vrai, avait déjà pris un sérieux coup au début de la crise
bancaire. Ainsi Franz Müntefering, lors d’une déclaration sur les pays où le secret
bancaire est encore en vigueur, peu enclin à faire dans la dentelle, ne pouvait résister
à la tentation de se référer au prestigieux passé militaire de l’Allemagne en lançant : « jadis on y aurait envoyé des soldats. » M Peer Steinbruck, autre figure de proue en RFA, maniant lui aussi les précautions oratoires avec le talent de l’homéopathe, n’avait pas manqué à son tour de mobiliser la cavalerie, du moins verbalement.
N’ayant pas encore réussi à réunir les citoyens autour d’un projet porteur, susceptible de sortir les 27 Etats membres de la crise, ces génies de la communication auront cependant marqué un point en réduisant la distance entre la politique et le comptoir du café du commerce. Faut-il dès lors s’étonner du fait que la crise de l’Euro, déclenchée par les révélations autour des déboires de la politique budgétaire hellène donne lieu à un traitement dédaigneux de la Grèce de la part de la RFA par le quotidien Bild interposé ?
Que la République hellène a beaucoup à se faire pardonner est hors de question. Que la situation individuelle d’un Etat membre de l’Eurogroupe ne reste pas neutre sur la santé collective de l’Euroland, est une évidence. De là à traiter toute une nation de
fainéants, en rappelant aux Grecs que les Allemands se lèvent tôt le matin et travaillent toute la journée, il y avait un long chemin à parcourir, dans le temps. Dans le temps oui mais plus aujourd’hui. La chute du prix des matières premières semble avoir entraîné dans son sillage également la perte de valeurs non négociables en bourse comme la tolérance, le respect, la solidarité ainsi que la dignité humaine sur l’irréductibilité de laquelle s’est construite l’intégration européenne.
M Papandreou, nouveau Premier ministre à Athènes, héritier d’une situation
budgétaire exécrable, construite sur l’approximation et le mensonge, mène un combat
courageux contre les pratiques d’antan. Etant donné qu’il doit lutter sur tous les fronts
afin de rétablir la confiance dans l’Etat grec, l’on peut comprendre son peu d’empressement à vouloir, de plus, revêtir le rôle de poubelle des mal éduqués de l’Eurogroupe. C’est sur cette toile de fond qu’il y a lieu de prendre acte de sa phrase assassine selon laquelle les Grecs n’ont pas la corruption dans leurs gênes tout comme les Allemands n’ont pas le nazisme dans les leurs.
January 14th, 2010 by Charles Goerens
Pas de fatalité !
Le sommet de Copenhague, il est vrai, a été un échec. Et la fin de la récession économique est tout sauf synonyme de reprise solide et durable.
Sur le long terme, le recul démographique ne manquera pas de générer des déficits gigantesques. Un milliard de personnes à travers le monde ne mange pas à sa faim. L’endettement public prend des proportions inquiétantes.
A politique inchangée, les besoins de financement seraient bien supérieurs aux ressources disponibles pour investir dans l’avenir.
A politique inchangée, bien entendu, car laisser tout en l’état et se borner à faire des extrapolations sur 20 ou 30 ans à partir des paramètres existants sans influer sur les politiques actuelles nous condamnera au déclin.
Devons-nous, dès lors, subir tout simplement la traduction de ces projections dans la réalité politique? Ne nous resterait-il plus qu’à capituler devant l’ampleur des défis? Pas nécessairement. C’est Klaus Töpfer, ancien directeur du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), qui nous apprend que la fatalité n’est pas forcément la seule attitude possible que l’on peut adopter dans une situation à première vue sans issue. Ainsi, ne manque-t-il pas de nous rappeler, non sans ironie, que la fin de l’AGE DE PIERRE n’était pas due à un manque de pierres, mais que c’était l’esprit d’innovation de l’homme qui avait finalement permis à l’humanité de progresser.
C’est dans la capacité d’innovation de l’homme contemporain que nous allons puiser l’espoir de mettre fin à l’ère du pétrole, du charbon et du gaz avant d’en avoir extrait la dernière molécule du ventre de la terre. Suffit-il d’être innovateur, imaginatif et audacieux pour relever, ce faisant, l’un des plus grands défis de notre époque car c’est bien de cela qu’il s’agit en l’occurrence ? La réponse est positive ou presque… On peut progresser, voire réussir, si on arrive à organiser la masse critique autour d’une grande idée susceptible d’ouvrir de nouvelles perspectives à nos citoyens. La volonté et la détermination politique vont s’avérer indispensables pour rendre la réalisation de projets de production d’énergie alternative d’envergure un peu moins illusoire.
Ainsi, dans le domaine de la promotion des énergies renouvelables, entre autres, peut-on constater que réalisation rime bel et bien avec ambition, vision et innovation. Dans cet ordre d’idées, la conclusion d’un accord impliquant 8 pays européens dans un grand projet de production d’énergie éolienne au large des côtes du nord de notre continent, et dont la capacité annuelle équivaut à 50 fois la consommation énergétique de notre pays sur la même période, nous redonne espoir.
Si l’essentiel reste encore à faire en matière de transition du « tout pétrole » vers des formules d’approvisionnement énergétiques plus durables, force est de reconnaître que la brèche est désormais ouverte. Dans ce domaine comme dans tant d’autres, posons-nous la question de savoir ce que nous pouvons faire de plus. La réponse va de soi : D A V A N T A G E.
December 10th, 2009 by Charles Goerens
Un «huis clos des nantis» pour sauver la planète?
Vous ne connaissez pas le G180? Pas besoin d’en avoir honte puisque la plupart de ses Etats membres ne sont eux-mêmes pas au courant de son existence. Le G180 est une organisation sans statut ni règlement. Aussi chercherait-on en vain son acte fondateur. Tous les Etats-membres du groupe «Afrique-Caraïbes-Pacifique» en font partie. Un ensemble de pays en développement donc? Non, parce que 23 Etats-membres de l’Union européenne, qui, de toute évidence ne sont pas à ranger dans cette catégorie, adhèrent également au G180. De plus, la participation d’Etats tels le Singapore, le Chili, le Vietnam, le Laos, l’Ukraine, la Géorgie, l’Islande, la Norvège, la Nouvelle-Zélande en fait un bel ensemble hétéroclite. Ni la pauvreté ni la richesse et encore moins une appartenance à un groupe linguistique ne vous prédestinent en tant que pays à y adhérer. Cela ne vous fait guère avancer mais une autre méthode nous permettra peut-être d’avancer dans la phase exploratoire. L’élimination ou l’exclusion vont sans doute nous aider à emprunter une piste plus prometteuse dans notre petite enquête, car l’adhésion à cet ensemble mystérieux n’étant pas le fruit d’un choix délibéré de ses membres, ceux-ci doivent logiquement l’existence du G180 à un phénomène indépendant de leur volonté. D’autres acteurs, par leur souci de se démarquer signent en fait responsables pour cette création hybride. Ce qui nous renvoie à la question du ou des critères retenus pour créer un ensemble distinct et exclusif. Mais qui sont-ils donc à vouloir créer une structure fermée aux autres et selon quel(s) critère(s)?
Vous l’avez deviné: Il s’agit bel et bien du G20. Le critère peut surprendre mais connaissant la psychologie de la plupart des membres du club, il n’est pas étonnant de constater que c’est finalement le PIB qui l’a emporté sur toute autre considération. Le Produit Intérieur Brut d’un pays qui confère prestige, pouvoir et considération à ses dirigeants – ceci explique cela – rend plus plausible encore la déconsidération dont souffrent ceux qui ne rentrent pas dans cette norme.
Le PIB est donc la clef qui vous donne accès à la Cour des Grands. Si, par malheur, en tant qu’Etat vous n’êtes pas suffisamment «PIBERTAIRE», vous restez dehors. Laissant cependant à Ségolène Royal le privilège d’inventer de nouveaux mots en rappelant que si le terme «pibertaire» existait en français, il ferait penser, bien entendu au mot «pubertaire». Cette connotation, à première vue, ne me paraît pas du tout déplacée dans le contexte du G20, étant donné que le terme «puberté» suggère l’idée de passage de l’enfance à l’adolescence. PIBERTAIRES, les dirigeants du G20, seraient-ils en retard d’une évolution? En effet, bien plus qu’une crise d’adolescence, il s’agit d’une véritable régression.
C’est bel et bien un remake du Directoire des Grands qui est bien antérieur à la naissance d’une «Union européenne sans cesse plus étroite» selon le Traité. Les deux premiers à s’en rendre compte à leurs dépens sont l’Autriche et le Luxembourg, tous les deux membres du G180. Les autres seraient bien avisés de se familiariser avec l’idée que les malheurs n’arrivent pas seulement aux autres.
Remake aussi d’une certaine approche de la démocratie tributaire du XIX siècle, où le droit de vote était basé sur un système censitaire: Le paiement du cens était indispensable à l’obtention du droit de vote. Cens au XIXème et PIB au XXIème siècle, les pratiques d’exclusion relèvent de la même pensée.